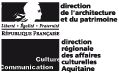Bertrand Genier (B.G.) : Ça fait combien de temps, que vous faites « Lacaton-Vassal » ?
Anne Lacaton (A.L.) : Ça fait bien vingt-cinq ans…
B.G. : Vous arrivez quand même à faire des choses !
A.L. : Oui, on y arrive, mais c’est au prix d’une énergie incroyable, et on voit bien que c’est de plus en plus difficile. Ce que nous avons pu faire à la Cité manifeste de Mulhouse, par exemple, on voit bien que ça ne serait pas reproductible, même si tout le monde loue ce projet, et reconnaît que c’est bien. Récemment, un groupe de chercheurs vient de faire un travail de cinq ans là-dessus, d’où il ressort que, passé la médiatisation, c’est vraiment un endroit où les gens vivent bien.
B.G. : Vous y revenez encore ?
Jean-Philippe Vassal (J.-P.V.) : Oui, nous passons beaucoup d’énergie et beaucoup de temps sur nos projets. En même temps nous faisons en sorte que ça soit assez plaisant, et excitant. Nous sommes contents de revoir M. et Mme Latapie, ou d’autres clients, comme ceux pour qui nous avons fait la maison à Coutras, par exemple, ou les habitants de la Cité manifeste, et d’autres encore. De ce point de vue, les choses marchent bien, et ça nous fait vraiment plaisir. Nous sommes allés récemment à l’école d’architecture de Nantes, et le directeur nous a raconté qu’il y a aujourd’hui quatorze associations d’étudiants dans la nouvelle école alors que dans l’ancienne, il n’y en avait que trois. Et du coup, il y a maintenant beaucoup plus de choses qui se passent. Et pourquoi ont-ils envie de faire des choses ? C’est bien parce qu’ils ont de la place, pour projeter, pour imaginer, pour se réunir, pour se lancer… Pour moi, ce sont des choses importantes et encourageantes.
A.L. : Oui, c’est même pour ça que nous persistons… Mais on voit bien qu’aujourd’hui c’est plus dur et que nous sommes obligés à passer plus de temps pour parvenir à faire les choses autrement, à démontrer que l’on peut s’échapper de la règle, tout en respectant les objectifs. Et ça, c’est un travail énorme et incessant.
B.G. : Tu parles de règlements, alors que « la crise » est dite de nature économique ?
A.L. : Oui, on dit ça, mais ce n’est pas vrai ! La crise est économique, mais ce n’est pas pour autant que les villes sont raisonnables quand il faut construire un musée, et que là, tout d’un coup, il n’y a plus de limites financières, comme on a pu le voir dans plusieurs projets récents. Quand il s’agit de ce type bâtiments icônes, la question de l’argent n’a plus d’importance, et les budgets sont facilement multipliés par trois ou par quatre… Et il y a un effet de brouillage, parce que tous ces gens tiennent par ailleurs un discours moraliste, et parlent doctement de développement durable, mais quand ils se trouvent face à ces monuments qui servent la communication, tout d’un coup, il n’y a plus de mesure. Je pense qu’on est encore loin de la prise de conscience, et surtout de l’honnêteté.
J.-P.V. : Pour moi, ce n’est pas tellement là le problème : après tout, qu’il y ait des bâtiments spectaculaires, iconiques, pourquoi pas. Admettons aussi que l’on continue à se permettre quelques folies. Ce qui m’inquiète plus, c’est la question de l’urbanisme et de l’aménagement urbain. Tout le monde est d’accord, par exemple, pour dire que le tramway, c’est bien, et que ça marche. Mais souvent, on s’engage dans des systèmes d’aménagement très complexes et chers. Tout le monde se souvient des tramways du siècle dernier : il y avait simplement des rails tracés dans l’asphalte, et c’est tout. On a l’impression d’avoir redécouvert la lune, alors qu’à un moment, on était très contents de les enlever, ces rails, et alors que dans d’autres villes, comme Vienne, Zurich ou Bâle, ils ont été gardés, et on voit aujourd’hui des tramways anciens qui fonctionnent toujours, avec à peine la trace des rails dans la rue. Pas besoin d’avoir une moquette de gazon, et si avec l’argent économisé, on avait pu faire davantage de kilomètres, ça aurait été certainement intéressant, non ?
Souvent, on considère le coût et l’économie de la construction des bâtiments, mais il y a quelque chose qui n’est jamais vraiment pris en compte, c’est l’économie de la ville. On ne cherche pas, par exemple, à repérer les parcelles existantes et déjà viabilisées, pour éventuellement construire des logements supplémentaires, si c’est nécessaire, et pour améliorer ce qui est déjà là sans faire une route, ni une adduction d’eau et d’électricité de plus. C’est ce que nous avions essayé de montrer à travers l’étude pour l’opération des 50 000 logements de la Communauté urbaine de Bordeaux : comment travailler sur cette économie de la ville ? C’est vraiment compliqué d’amener ce genre de réflexion sur la table, au niveau d’une recherche. Et quand on s’aventure sur ces questions de fond, on se rend compte que les choses sont complètement opaques et régies par un marché qui conduit à vivre mal. Si, aujourd’hui, on a 25 000 personnes qui vivent dans la rue à Paris, et si une chambre de 6 m2 coûte 500 euros par mois, c’est parce qu’il y a un marché qui organise et maintient la pénurie.
A.L. : Si on en revient à la question précédente, c’est évident qu’il faut des musées, et il faut même des choses qui ne servent à rien, mais la question, c’est de savoir à quel moment on bascule, soit dans le plaisir de l’architecte, soit dans la démesure du politique, ou le tout mélangé. Il y a le discours, et il y a le reste…
Et finalement, de tous ces discours, toutes ces expositions, ces conférences qui disent des choses, quel est vraiment leur impact sur ce qui se fait dans la réalité, et qui engage des décisions, de l’argent, des façons de faire ? C’est comme si on était tous très satisfaits de mettre des questions sur la table, alors qu’on est moins regardants sur l’effet qu’on pourrait en espérer. Ce n’est pas du tout le cas, par exemple, dans les pays nordiques, où, me semble-t-il, on fait preuve d’un peu plus de sérieux et de rigueur. Je m’interroge quand un politique, ou une ville, sont capables d’une chose et de son contraire…
J.-P.V. : Quand ce qu’on dit n’est pas la même chose que ce qu’on fait, plus personne n’y comprend rien, et plus personne ne sait ce qu’il faut faire, et au bout d’un moment, ça détruit toute lisibilité, toute rigueur et toute motivation.
B.G. : Pour en revenir à la question de la monstration et du débat, bien sûr que l’on peut se poser des questions, mais pourtant, ne faut-il pas révéler des choses, qui sont souvent modestes, ou de faible intensité, mais qui sont masquées par le discours ambiant ? Et ne faut-il pas repartir du terrain, aller voir ce qui se fait, et qui n’est pas forcément très médiatisé, plutôt que de développer des grands discours ?
A.L. : Oui, bien sûr, je suis d’accord avec toi, c’est tout à fait ce qui faut faire. Mais le discours qui doit accompagner cela, c’est de dire clairement que, si ça, c’est bien, alors le reste n’est pas bien. On ne peut pas valider les deux ! Sinon, ça prouve bien qu’au fond, on n’y croit pas vraiment.
Marie Bruneau (M.B.) : Votre actualité par rapport à l’Afrique ?
J.-P.V. : Nous avons deux projets en cours. Le premier date de près de dix ans, et il a mis tout ce temps à démarrer, mais là, il est en construction. On pourrait faire référence à ce style international, et aux immeubles des années 1950 de Casablanca : c’est un hôtel de luxe – cinq étoiles –, sur la presqu’île de Dakar, avec de grands balcons, piscine, club de sport, boutiques… et vue sur la mer. Architecture très simple : poteaux, poutres. Un beau projet, qui en est actuellement au cinquième étage de la construction. C’est assez agréable pour nous de travailler avec les ingénieurs de là-bas…
Le deuxième projet se situe à l’intérieur du Sénégal. On est presque à l’est, à la frontière de la Mauritanie, dans le désert, dans un tout petit village qui s’appelle Agnam, avec une seule route d’accès, ravagée par le sable, et des gens sont venus nous voir avec l’idée de faire là un musée, ou un centre culturel des cultures peules. Il se trouve que les Peuls sont partout : il y en a aux États-Unis, en Allemagne, en France, etc. Depuis deux ans, nous nous réunissons à peu près une fois tous les deux mois avec eux pour essayer de bâtir un programme, avec vraiment trois francs six sous…
A.L. : Déjà, ils n’ont pas de collections : tout a été pris, tout est dans les grands musées internationaux. Comment faire un musée, quand on n’a pas d’argent, pas de collection ?
J.-P.V. : Et qu’est-ce que c’est qu’une construction, pour des gens qui sont les plus grands nomades qui existent ? Comment faire pour ne bâtir aucun mur, aucune clôture ?
A.L. : C’est assez drôle, parce qu’en trois ans, on a déjà réussi à décourager les ayatollahs de la muséographie, pour se dire : bon, commençons par faire un toit, et puis les gens du village vont venir faire quelque chose…
B.G. : Juste retour des choses !
A.L. : Ce qui est beau, c’est qu’il y a un grand enthousiasme là-bas, autour de ce projet. Ils organisent des collectes qui, quand elles ont un succès fou, leur permettent de récolter 100 € !