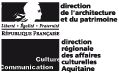Bertrand Genier (B.G.) : Ce que vous dites, et ce que vous faites, par rapport à l’habitation, pourrait-on le déployer de la même façon par rapport à l’urbain ?
Jean-Philippe Vassal (J.-P.V.) : Oui ! Habiter ne se limite pas à sa chambre, sa salle de bains, son séjour et son jardin. Habiter, c’est aussi aller à la bibliothèque, au musée, ou se balader dans la rue, aller au travail (finalement, on passe bien souvent plus de temps au travail que chez soi, et là aussi, il n’y a pas de raison que, dans les bureaux par exemple, il n’y ait pas un balcon pour prendre l’air…). Habiter, c’est un état permanent, de la chambre à la ville, et au paysage. Cette notion est primordiale. L’espace que l’on construit doit se définir par rapport à cette permanence de l’habiter. Je pense aussi qu’il s’agit de démocratie. On continue à pratiquer aujourd’hui un urbanisme et une architecture du 19e siècle, une manière de raisonner qui n’évolue pas : il faut vraiment regarder les avancées et les expériences qui ouvrent de nouveaux possibles dans ce domaine. Pour revenir à l’exemple de Berlin, il y a là des associations qui mobilisent, qui achètent des immeubles abandonnés à bas prix, trouvent des architectes pour leur faire des projets pour pas grand-chose, et au final qui proposent des logements à 800 € du mètre carré, alors qu’à Paris, c’est 5 000 € ! À Johannesburg, dans Heathrow, des gens réunis en sortes de syndics, qui connaissent tout le monde et qui savent tout faire, ont réussi à réutiliser les tours de bureau, les hôpitaux, les hôtels délaissés, pour fabriquer du logement. Ils ont contacté des avocats pour parvenir à établir qu’après 20 ans de travaux dans ces immeubles abandonnés par leurs propriétaires, on pouvait obtenir des titres de propriété pour les occupants. Je pense qu’il y a bien d’autres endroits dans le monde où les choses commencent à exister de façon différente. Et ces choses ont à voir avec le plaisir que chaque corps peut prendre à vivre dans chaque espace de la ville.
Anne Lacaton (A.L.) : C’est un peu ce que nous avons essayé de faire émerger dans notre contribution au programme des 50 000 logements, initié par la Communauté urbaine de Bordeaux. Aujourd’hui les territoires des villes sont constitués et il n’est pas très intéressant de se mettre à faire des grands tracés. Nous défendons l’idée que faire de l’urbanisme, maintenant, c’est commencer par le petit espace de qualité individuelle. Et que c’est une addition de ces qualités individuelles qui, en considérant la variété des situations et les relations qu’elles entretiennent, produit de l’urbanisme. Nous croyons assez fermement que la qualité urbaine commence par la qualité de l’espace individuel – et non le contraire comme on a pu le pratiquer, et où il s’agissait de définir un grand dessein, avec la conséquence que plus on descend vers l’individu, plus les espaces se compressent, avec la fabrication des logements formatés que l’on a pu voir un peu partout… Notre démarche paraît pourtant assez simple à mettre en place : il suffit juste de changer un peu la façon de travailler, d’accepter de regarder les choses dans le détail, et quand une question est posée, de ne pas chercher à répondre à la question d’à côté.
B.G. : Vous avez dit aussi : « Ne rien soustraire… »
J.P.V.: Oui, c’est ça. Ne rien soustraire, toujours ajouter ! Il n’y a pas un arbre à couper, un rosier à enlever, une maison à supprimer, ou un immeuble à démolir. Il y a à travailler à partir de cette complexité, et à en tirer une richesse supplémentaire. Et pour les architectes, c’est une source d’intervention et de travail. Si les tours et les barres de banlieue posent des problèmes, quand on y va, on se rend compte que certains habitants y ont développé un univers dans leur appartement, un esprit de voisinage et une convivialité intéressants, et qu’il faut prendre soin de cette richesse, qui peut se perdre facilement. Il faut faire avec tout ça, et on peut agrandir, et trouver des solutions, en permanence. Pour moi, ces choses-là sont très en rapport avec notre expérience en Afrique. Il s’agit toujours de se débrouiller avec ce qui est déjà là. Parfois c’est un bout de bois, ou un peu de paille, ailleurs, c’est un trou dans la ville, une usine abandonnée, une tour qu’on est prêts à casser, un aéroport qui ne sert plus… Les situations sont très différentes, mais c’est toujours la même démarche : partir des gens, parler avec eux, trouver des façons de les associer à ce travail. Jusqu’à présent, ici, on s’est peu occupés du logement, et on a travaillé sur l’espace public : on a fait des parterres, des ronds-points, des aménagements urbains… Cette économie, on pourrait vraiment la transférer pour aider les gens à développer par eux-mêmes des procédures de proximité. Je pense qu’il faut partir du logement. Celui d’une personne, et celui d’une autre personne. Entre eux deux, une relation se crée. Au-delà, dans une tour par exemple, tous les habitants d’un même immeuble sont capables aussi de faire quelque chose ensemble. Et au-delà, ils sont capables, avec ceux de l’immeuble voisin, de faire encore quelque chose d’autre… Et la vie peut continuer, comme ça. En Afrique, ça existe : il y a une forme de discussion, de relation, qui fait partie de la vie. Nous sommes malheureusement aujourd’hui dans un système où un décideur demande à un urbaniste de faire un plan d’aménagement pour traiter de vingt parcelles ; alors sur chaque parcelle on organise un concours d’architecture, et chaque architecte fait son petit projet, en respectant 5 mètres de distance par rapport aux limites de sa parcelle…
A.L. : Pour varier, on demande à l’un de faire des balcons filants, à l’autre de ne pas faire de balcons, au troisième d’utiliser du bois… Ce n’est pas de la caricature, c’est comme ça. Nous avons eu à travailler dans certains secteurs, comme à Boulogne, par exemple, ou le cahier des charges était rédigé ainsi : sur cette parcelle, on demande cet architecte, parce qu’il sait faire des grandes baies vitrées, mais le voisin va faire une façade avec des fenêtres… Au nom d’une diversité des écritures, qui n’a pas vraiment de sens. Si on se pose la question du point de vue de l’intérieur des logements, on ne peut pas raisonner de cette manière : si, par exemple on se donne l’objectif d’ouvrir le logement vers l’extérieur, il faut ouvrir partout. Et si on réalise que c’est un luxe incroyable de pouvoir passer d’une pièce à l’autre, non pas par le couloir, mais par le jardin d’hiver ou le balcon, alors, on a une raison suffisante pour équiper tous les immeubles de ce type de plate-forme. Mais au fond, la répétition, esthétiquement, est-ce un problème ? C’est là que nous avons encore du chemin à faire pour se départir de certaines façons de voir les choses un peu trop conventionnelles.