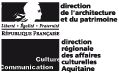Bertrand Genier (B.G.) : So after your second stint in South Africa, in 2001, you decided to be an architect? How do you manage to make your work echo what you’d experienced over there, and what you’d learned? You’ve mentioned freedom and improvisation… You also say that in South Africa they never refer to « harmony » or to what is « harmonious » … What are the other forces that have since influenced your work on the project?
Christophe Hutin (C.H.) : What’s clear to me is that in South Africa I learned a lot in intellectual terms but also in terms of my attitude, my way of living and behaving. To refer to Mandela, because it’s topical right now, I embrace the idea of a «long road to freedom». If there’s one thing that made its mark on me in South Africa it’s that idea of freedom. They fought to win freedom, whereas here we neglect it: we don’t use this great freedom we have! We live in a country of self-censorship, not censorship, that’s what the experience taught me. And every time I go there, I come back charged with positive energy.
In South Africa there’s a culture, an approach to life that lies in the philosophical domain from the outset: when you don’t have much, you’re relieved of a number of burdens. It’s such a contrast with what we experience here, in a society where assessment protocols and normative approaches seem to have won out over thinking, especially critical thinking! That’s where we are right now: the homes you can see being built everywhere in Bordeaux and elsewhere, are the result of normative approaches. The architect isn’t the thinker behind the home, he’s become a mere operator.
Pour ma part, je n’ai pas envie de ce statut : je souhaite assumer la responsabilité de ce que je fais. En Afrique du Sud, il ne peut en être autrement, car on se trouve directement placé face à un problème – en l’occurrence, comment faire un logement avec trois fois rien ? Et la seule façon de s’y prendre, au lieu de le considérer cela comme un problème, c’est de le voir comme une expérience, comme une opportunité pour inventer.
Voilà ce qui est formidable, et voilà ce qui nourrit mon travail, ici.
Marie Bruneau (M.B.) : Tu parles également de la joie…
C.H. : Oui. Il y a une forme de légèreté dans le quotidien, bien loin de notre tendance à nous engluer dans des problèmes matériels : un matin, à Soweto, j’arrive chez des gens dont la maison venait d’être entièrement détruite par un orage, pendant la nuit : leur lit était dans une flaque d’eau. Et je les trouve là, morts de rire, et plaisantant de leur mésaventure : « Notre maison est par terre : il ne nous reste plus qu’à la reconstruire ! »
B.G. : Pourquoi revenir en Afrique du Sud, maintenant, avec des étudiants ?
C.H. : J’ai beaucoup appris, là-bas, mais je ne me suis jamais permis d’aller « apprendre » quelque chose aux Africains… Par contre, je voulais, en retour, leur proposer quelque chose. Dans un premier temps, j’ai envisagé d’aller m’installer à Soweto comme architecte public, en me disant que, si je ne pouvais pas espérer gagner grand-chose, au moins je prendrai énormément de plaisir à faire ce travail. Puis je me suis demandé comment intervenir sur les programmes RDP, et remédier à l’absence d’architecture dans leur mise en œuvre. Mais aucun de ces projets ne me convenaient tout à fait…
Aujourd’hui, il y a deux écoles d’architecture en Afrique du Sud, implantées au sein des universités prestigieuses de Johannesburg et de Cape Town, fréquentées à 80 % par des blancs. Je suis convaincu que la seule action intelligente à mener serait d’ouvrir une école d’architecture à Soweto. Mais je n’en ai ni les moyens, ni les compétences à moi tout seul. J’ai alors imaginé un dispositif léger, me permettant de mener des actions de formation à l’intention des jeunes architectes, et leur permettre de venir travailler sur ces sujets, en relation tous les partenaires qui interviennent sur ces programmes – et donc de faciliter l’accès à ce genre de travail pour de jeunes architectes. Certains pourraient peut-être, comme j’ai pu moi-même le faire, se découvrir dans ce genre de situations, et comprendre là, au travers d’une pratique, quel architecte ils pourraient être.
M.B. : Une maquette d’école, en quelque sorte ?
C.H. : Oui, d’une certaine façon, et à petite échelle. Il me semblait possible d’inventer, ou du moins de stimuler, chez les jeunes architectes, une culture du projet qui pourrait les inciter à s’engager sur ces sujets et à s’y consacrer pleinement, au lieu d’aller construire des immeubles de bureaux sur des modèles importés.
Par chance, j’ai trouvé des fonds qui m’ont permis de monter des actions ouvertes aux étudiants en architecture sans distinction de niveau : on n’était pas dans un format de master class calée sur une formation universitaire (en particulier, nous n’exigions aucun prérequis : j’ai même accepté, avec plaisir, des jeunes qui étaient en formation professionnelle de charpentier). Nous avons ainsi pu, pendant plusieurs années successives, travailler sur des cas précis, avec une trentaine de jeunes gens. À chaque fois, j’invitais des gens pour accompagner la démarche et nourrir la réflexion : parfois des avocats, parfois des économistes… Francis Kéré et Jean-Philippe Vassal ont ainsi fait le voyage vers l’Afrique du Sud. J’avais donc réussi à trouver un financement pour mener ces actions par le biais des instituts culturels européens.
À cette époque-là, j’étais un électron libre, une sorte de Don Quichotte… Après les trois premières années, formidables, j’ai senti que le projet allait s’engluer dans une routine ; les instituts culturels commençaient à vouloir imposer une logique de représentation institutionnelle, il fallait absolument inviter certains architectes européens, etc. Par ailleurs, je venais d’être recruté comme enseignant à l’école d’architecture de Toulouse, et c’était donc l’occasion d’inventer une nouvelle formule. Je souhaitais mettre en pratique la notion d’échange : de la même manière que j’avais pu me trouver en allant dans les townships, ne fallait-il pas amener de jeunes français à vivre une expérience similaire – non pas en tant que supérieurs techniques qui viendraient apporter des solutions à ces pauvres Africains, mais en tant qu’architectes en devenir, qui soulèvent des questions, et en tout cas qui portent les leurs ? C’est l’essence de l’atelier que nous avons nommé Learning from2. La première session s’est déroulée en 2010, dans un ancien hôpital abandonné du centre-ville de Johannesburg – un bâtiment de style art-déco, magnifique –, dans lequel 250 familles se sont installées, sans aucun travaux : ici le bloc opératoire, très soigneusement décoré, est devenu un appartement ; là, les laboratoires d’analyses biologiques, entièrement carrelés, ont été transformés en crèche autogérée de l’immeuble ; dans la cave, la chapelle d’origine est toujours en place, avec tout son mobilier… Avec les étudiants, nous sommes allés sur place pour documenter cette situation. Nous voulions en comprendre l’organisation, le fonctionnement. Mais la population qui vit là est souvent en situation irrégulière, et pour éviter d’être à l’origine d’une éviction, nous avons travaillé en relation étroite avec des avocats militants. Ce travail a soulevé des questions extrêmement complexes et passionnantes : pour des architectes, c’est vraiment à partir de ce genre de situations qu’on peut commencer à penser !
B.G. : Aller voir, et comprendre comment la vie s’installe dans un ancien hôpital, c’est une expérience spatiale exceptionnelle…
C.H. : On se rend compte qu’avec rien du tout, ces gens parviennent à faire des choses que nous ne pourrions même pas envisager. Installer une crèche dans un immeuble, ça coûte combien, chez nous ? Allez, au bas-mot deux millions d’euros ! Là-bas, il n’y a pas un sou, et voilà une crèche en état de marche, ouverte tous les jours, propre, etc. C’est une leçon de vie, non ? En tout cas, ça m’apprend beaucoup de choses, et surtout, ça me renseigne sur l’architecture : c’est la preuve vivante de la justesse des réflexions de Michel de Certeau, et de bien d’autres. Passionnant. Et tout ça ne se limite pas à des questions d’architecture, car l’architecture, ce n’est pas une fin en soi ! On voit bien qu’il y a d’autres enjeux, que ça soulève des questions d’ordre politique, social, juridique, etc.
M.B. : Aller voir, et documenter : ta démarche commence toujours par là ?
C.H. : Oui, la documentation est obligatoire. Sans elle, on ne peut rien faire.
M.B. : Tu enseignes toujours à Toulouse ?
C.H. : Oui. Et nous partons chaque année en Afrique du Sud, pour 15 jours. L’année dernière nous avons fait un worshop à Cliptown, pour reconstruire un orphelinat, et le match retour s’est tenu à Uzeste3, avec Bernard Lubat. Il y a très longtemps que je rêvais de travailler ainsi, en miroir, mais ce n’est évidemment pas possible. Pour nous, aller en Afrique du Sud ne pose aucun problème : pas besoin de visa, il suffit d’une carte bleue, d’un passeport et d’une brosse à dent, et hop ! le lendemain matin, on est à Johannesburg. Mais on n’imagine pas les démarches nécessaires avant de parvenir à faire venir un Sud-Africain en France : ça dure trois mois… Invraisemblable. L’an dernier, dans le cadre des Saisons croisées, entre France et Afrique du Sud, nous avons bénéficié d’une conjoncture favorable qui nous a permis de construire le même dispositif ici et là-bas, et donc de faire venir à Uzeste les gens du township avec lequel nous avions travaillé.
M.B. : La musique est très présente, dans ce projet : c’est frappant, quand on regarde les vidéos qui le retracent.
C.H. : Oui, bien sûr, et pourtant les personnes qui sont venues en France ne sont pas des musiciens : il y avait le directeur de l’orphelinat, un jardinier et un maçon, ainsi que trois jeunes filles de l’orphelinat. Ces gens n’étaient quasiment jamais sortis de Soweto. Les trois jeunes filles font de la musique et de la danse, et l’une d’elles s’est très bien entendue avec Bernard Lubat et elle a eu l’occasion de s’essayer à la batterie à Uzeste.
M.B. : On a l’impression qu’il n’y a pas tellement de différence, finalement, entre faire de la musique, et faire une maison…
C.H. : J’aime bien me servir de la musique pour faire comprendre certaines choses sur l’architecture : quelqu’un va faire le conservatoire (traduire : l’école d’architecture), où on va lui apprendre à interpréter. Au bout de huit ans, il saura très bien jouer du piano, mais sera-t-il devenu un musicien pour autant ? Le jazz pose très bien cette question-là : la liberté d’un musicien de jazz ne se conçoit pas sans prise de risque : Bernard Lubat, en concert, ça peut être magnifique… comme très mauvais ! Et c’est normal, c’est expérimental, c’est improvisé, on peut se tromper ; d’ailleurs ce n’est pas grave. Alors, finalement, plus on se trompe, moins on se trompe ! En architecture, c’est pareil : soit on déroule un système et on en est l’interprète, l’opérateur, soit on décide de travailler différemment…
M.B. : C’est la question de la liberté, qui se pose ici : pour travailler différemment, il faut se sentir libre…
C.H. : Exactement. Et c’est une chose qui ne tombe pas du ciel : ça se travaille ! Il faut s’assumer, il faut aussi lutter un peu, quelquefois.
Un dernier mot de conclusion, à propos de l’Afrique du Sud et de l’enseignement : j’ai obtenu de très bons résultats en travaillant de façon totalement libre, et sur la base du volontariat, avec des étudiants sud-africains, parce que je suis tombé sur des jeunes – souvent issus des townships – qui avaient vraiment envie de s’engager. Mais quand on fait des études d’architecture à Johannesburg, on vous apprend plutôt à faire des villas de 500 m2, en bord de mer. J’ai enseigné là-bas pendant un semestre, sans arriver à comprendre comment on pouvait donner de tels sujets à des jeunes blacks dont on sait, si on discute un peu avec eux, dans quel quotidien ils vivent ! De vieux anglo-saxons nostalgiques qui ont fait toute leur carrière sous l’apartheid (mais qui sont contre, aujourd’hui, bien entendu), leur font dessiner des projets du XIXe siècle. Ce qui génère un décalage énorme, incroyable, entre les attentes d’un étudiant, son idéal, et les contenus de l’enseignement qui lui est proposé. Et c’est bien sûr tout cela que je voulais bousculer, à travers toutes les actions et les workshops que j’ai montés en Afrique du Sud.4
Aujourd’hui, je suis dans une école d’architecture, et j’interviens à partir de là. De fait, c’est plus difficile. Dans la mesure où je suis à l’intérieur de l’institution, et où je dois rendre compte d’un certain nombre de choses, j’ai moins de liberté. Par exemple, sur les Saisons croisées, le seul moyen que nous ayons eu de pouvoir faire venir les Sud-Africains à Uzeste, c’était d’avoir un échange universitaire, institutionnalisé. Et je dois dire que nous avons vécu un échec catastrophique : les jeunes qui sont venus travailler avec nous sont des étudiants blancs de l’université. Sur l’orphelinat, il était hors de question pour eux de prendre leurs repas de midi avec nous ; ils sont venus quelques demi-journées, pour finalement abandonner. Et ça, c’est dur ! Quand, pour le match retour, nous avons eu un budget pour le déplacement, je voulais faire venir les gamins de l’orphelinat. Et, en l’occurrence, les étudiants ne m’intéressaient pas : ils ont déjà les moyens de voyager en Europe, alors que les gamins de la township n’ont rien. Mais j’étais obligé de faire venir des étudiants pour avoir l’argent qui me permettrait de faire voyager les autres : voilà le genre de compromis que l’on peut parfois accepter, pour arriver à ses fins…
M.B. : Tu continues toujours à engager ce genre d’échanges ?
C.H. : Oui, en ce moment même (2013), nous sommes en train de travailler sur le prochain projet. C’est dans le même quartier, de Kliptown, hautement symbolique puisque c’est ici qu’en juin 1955, a été signée la charte de la liberté. Plusieurs lieux de commémoration. Une voie ferrée. D’un côté, un développement urbain, comme on les connaît partout dans le monde, et de l’autre côté de la voie ferrée, 50 000 habitants qui vivent dans un bidonville. Et là, rien n’a été fait, c’est-à-dire que l’État sud-africain n’a pas investi un euro. Nous avons refait cet orphelinat, qui était une institution très ancienne, portée par les habitants, et qui ne reçoit aucune aide de nulle part. Il y a, dans ce quartier, un cinéma en ruine : Le Sans Souci5. Ce cinéma était le seul, sous l’apartheid, à être ouvert aux Africains. C’était aussi un lieu de production culturelle, et une salle de concert. Ont débuté là, du temps de l’apartheid, Miriam Makeba, Abdullah Ibrahim et bien d’autres jazzmen sud africain. Ceux qui sont encore en vie sont d’accord pour revenir jouer gratuitement là, si on refait le cinéma. Notre projet, c’est de faire venir là-bas en avril Bernard Lubat et les jeunes d’Uzeste – le match retour du match retour, en quelque sorte… –, qui conduiront un workshop musique, dans l’orphelinat et avec les gamins, pour une production musicale en fin de semaine. Nous sommes en train de travailler, avec mes étudiants, sur un projet de rénovation du site. Il n’est pas question de le reconstruire le cinéma : ça n’aurait pas de sens. Nous allons d’abord refaire les sols de la parcelle, pour en faire une place publique, sur laquelle on pourra venir poser des structures événementielles. Nous avons proposé, par exemple, à un gros festival de jazz à Johanesburg, qui se déploie en trois scènes dans la ville, de délocaliser l’une de leurs scènes à Soweto. Nous gérons les sols, et eux vont arriver avec une scène temporaire, qui permettra à des milliers de gens de venir voir des concerts, sur le site. Dans un second temps, nous allons faire une petite salle foraine – une structure très légère, un peu à la façon de Patrick Bouchain – à l’intérieur de laquelle pourront se tenir des séances de projection ou des petits concerts. Notre objectif, c’est de faire la première tranche de ce projet au mois d’avril. Ce que nous faisons là n’est pas très à la mode. Il ne s’agit pas du tout de la charité, ça n’a rien à voir avec ça : c’est un échange. Nous faisons des choses ensemble, les étudiants se forment au travers de cette expérience, ça nous permet de projeter une architecture intéressante, et pour moi, de prolonger mon engagement avec Soweto, initié depuis très longtemps. Nous avons plusieurs partenaires : l’entreprise Laffarge, qui nous a déjà donné du béton hydromédia6, l’un des derniers matériaux qu’ils viennent de mettre au point, une vraie prouesse technique, va encore nous aider, pour le sol. J’ai rendez-vous prochainement avec Marin Karmitz, producteur et réalisateur français, fondateur de la société MK2, pour envisager les moyens de former un jeune du quartier pour être régisseur du cinéma.
NOTES
1. Cet entretien s’est déroulé quelques jours après le décès de Mandela, le 5 décembre 2013.
2. voir http://learning-from.over-blog.fr
« L’atelier Learning From enseigne la conception par l’action en architecture. Il aborde le projet d’architecture dans des contextes populaires internationaux. Il soutient la collaboration interculturelle et l’hétérogénéité dans la production de la ville contemporaine. Ici, apprendre et faire sont deux versants d’une même attitude de concepteur où l’architecte, voyageur de l’esprit, est un praticien réflexif. Nos découvertes et nos expériences nous construisent. Dans la logique de l’enseignement d’émancipation, l’atelier Learning From affirme que ce qui est fait se discute, se partage, se pense : « Ne disons rien que nous n’ayons fait ! ». Le fait est la chose commune qui place toutes les intelligences à égalité. L’architecture, comme la ville, est faite par constellation, non par planification, et dans cette production sociale tout le monde est bienvenu. Les maîtres sont ignorants et les situations réelles de la société deviennent des institutions éduquantes. L’attention au “déjà-là” est présente au départ de chaque projet. Elle entraîne les étudiants vers la nécessité de s’informer du monde par l’observation, la relation et l’expérience. Il s’agit d’élargir sa propre perception de la réalité.
Entre Kliptown à Soweto et Uzeste en Gironde, deux contextes dialoguent. Ils parlent de ruralité contemporaine, d’engagement, d’improvisation collective et d’action directe sur le milieu de vie. Ils parlent aussi de construire. D’abord un désir, dans tous les sens du terme : accord des volontés et goût de l’autre. »
3. http://www.uzeste.org
4. Voir à ce sujet la documentation disponible sur mon site.
http://www.christophehutin.com/CH/recherches.html
5. http://learningfrom.olympe.in
6. http://www.lafarge-france.fr/Fiche-produit-beton-Hydromedia-lafarge.pdf