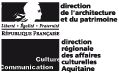Bertrand Genier (B.G.) : Peux-tu nous parler de ta récente expérience à Détroit ? Après avoir travaillé sur la ville qui se développe, tu travailles maintenant sur la ville qui rétrécit ?
Christophe Hutin (C.H.) : Oui, d’une certaine façon ! J’ai donc été invité à intervenir1 dans un quartier situé au sud-ouest de la ville, près des usines Ford. Une maison sur deux, ici, est vacante, en raison des expropriations de ses habitants par les banques. Les gestes de sabordages se multiplient ; pour empêcher toute spéculation sur leurs biens immobiliers, certains habitants expulsés mettent le feu à leur maison, parfois distante d’à peine un mètre de sa voisine… Tout cela engendre un climat complexe, dans un contexte de difficultés économiques plus général, et propre à cette ville. Lucides, les gens de Détroit ont compris que la macroéconomie n’aurait aucune incidence sur leur quotidien. À l’initiative de plusieurs organisations d’habitants, et en coordination avec l’université de Détroit, l’ambassade de France propose de financer la venue d’un architecte français, pour faire un projet. À l’issue d’un concours, je suis identifié par les habitants, en raison de mon travail en Afrique du Sud, et particulièrement de cet orphelinat que nous avons reconstruit, avec la participation de 120 personnes de la communauté, à Soweto.
Venant des Américains, ce choix m’a vraiment surpris, car, finalement, c’est un modèle d’action dans un bidonville, en Afrique, que l’on souhaite importer ici, à Détroit, USA ! Je lis cela comme un signe des temps, incroyable. Ainsi donc, malgré une approche anglo-saxonne de l’architecture plutôt formelle et universitaire, les difficultés conduisent certains à adopter une attitude de pragmatisme érudit.
Marie Bruneau (M.B.) : C’est plutôt encourageant, et ça veut bien dire qu’il ne faut pas baisser les bras…
C.H. : Non, mais ce qu’on peut remarquer, c’est que l’initiative, encore une fois, vient des habitants, et que l’université est un peu à la traîne sur ces questions, alors que c’est elle qui devrait être le moteur des innovations.
B.G. : Donc, vous avez commencé à travailler ?
C.H. : Oui, j’ai passé une semaine là-bas, le projet s’est fait en une semaine, et je me suis régalé ! C’est un tout petit projet, mais il en dit long sur la façon dont on pourrait procéder. Notre partenaire, c’était le Detroit Collaborative Design Center (DCDC) 2, un département de l’université de Détroit. Ces gens ont l’ambition de faire des projets collaboratifs. Ils travaillent avec une organisation communautaire formée de jeunes gens attachés à leur quartier, qui veulent continuer à y vivre malgré le départ de leurs parents. Ils se bougent, ils s’occupent des maisons en ruine, etc., mais tout se passe dans une grande précarité car il n’y a plus aucun service public en état de fonctionner.
Ils avaient donc identifié une parcelle, sur laquelle ils voulaient faire un projet. Et j’avais mission d’accompagner cette démarche. Une parcelle d’angle, dans un quartier de maisons (c’est précisément là que Clint Eastwood a tourné son film Gran Torino), sur laquelle on venait de démolir un ancien club de vétérans de la guerre du Vietnam.
Je suis arrivé un dimanche soir, et je devais faire en sorte qu’on puisse inaugurer le projet le samedi suivant. Avant ma venue, j’avais demandé aux étudiants de documenter la question : connaître les habitants, inventorier tous les sujets, savoir quels étaient les problèmes à traiter3. De la même manière que pour refaire l’orphelinat de Soweto, le sujet n’était pas de faire une démonstration, ni de dessiner un bâtiment très beau : il fallait commencer par identifier tous les problèmes, pour essayer ensuite d’imaginer des dispositifs permettant d’améliorer le quotidien, en partant vraiment de la base, c’est-à-dire des choses qui sont déjà en place. Pendant trois mois, le département de l’université a mis en place un atelier, et les étudiants ont mouliné sur le sujet… Ils ont rendu des panneaux au format A0, avec des titres, des mots, reliés par des flèches – s’amuser… se promener… –, des plans-masse sur lesquels la parcelle était représentée en gris, comme un sol neuf… Bref, ils avaient fait « du design » dans un académisme affligeant. Pour les provoquer, j’ai récupéré sur Street View, les photos des façades de toutes les maisons du quartier. Sur certaines images, on voit des habitants devant leur maison, on voit ceux qui ont des arbres et ceux qui n’en ont pas, on voit une rampe d’accès et on comprend bien que la personne qui vit là est en fauteuil roulant, on voit les autocollants et on peut savoir qui est républicain et qui est démocrate, etc. Bref, toute la complexité de la vie, telle qu’on peut l’appréhender par la documentation. C’était ma façon de leur dire : « voilà le sujet ! »
Les étudiants avaient imaginé des structures en bois, avec des ombrages, des bancs. Tout un système de structures assez compliquées, et chères à construire… Le lundi, quand ils m’ont présenté leurs documents, je dois dire que j’étais assez déprimé. En même temps, j’étais dans une situation plutôt gênante par rapport aux enseignants : difficile de les désavouer devant leurs étudiants. J’ai alors expliqué que je n’étais pas charpentier, et que je ne leur serai d’aucune aide pour réaliser ce genre de travaux. Et je leur ai proposé l’organisation suivante : « Voilà, je rêve d’aller voir les Indiens dans le Nord du Michighan4, donc je vais aller me promener, et quand je reviens, à la fin de la semaine, on inaugure ce que vous aurez fait : de cette façon, je ne gêne personne, je ne suis moi-même pas gêné, et tout va bien ! » Et puis, nous avons réfléchi : s’ils étaient dans une démarche de production complètement académique, c’est qu’ils avaient fait ce qu’on leur avait demandé de faire, mais ils sont moins bêtes que ça, les étudiants ! Nous avons donc décidé de nous rendre à pied sur le terrain, tous ensemble. Arrivés là, nous avons trouvé une grille avec un portail fermé par une chaîne et un cadenas. « La première chose qu’il faudrait faire, leur dis-je, c’est de couper la chaîne. Et ça sera peut-être suffisant : juste ouvrir le terrain, et en rendre l’usage aux habitants du quartier. » Et j’ai ajouté : « Comme vous avez l’ambition de faire des choses avec les habitants, vous devez les connaître. Nous allons faire du porte-à-porte, et aller voir tout le monde. » Nous avons donc invité les habitants du quartier pour 18 heures sur la parcelle, et nous avons officiellement ouvert le terrain, en coupant le cadenas avec une pince-monseigneur. C’est très symbolique, mais ça a très bien fonctionné. C’était une première action. J’ai dit : « Écoutez, comme je suis un peu fainéant, c’est peut-être suffisant, non ? » Mais comme nous étions sur place, nous avons observé le terrain : il y avait encore la trace de l’ancien bâtiment démoli, et visiblement, en sous-sol, une conduite d’eau de la ville, qui était percée. Et comme il n’y avait plus de services publics, donc évidemment, personne pour la réparer, on se retrouvait avec un plan d’eau, potable, en plein milieu du terrain ! Toutes les propositions d’aménagement imaginées à l’université devenaient, de fait, impossibles : il aurait fallu réparer le tuyau et pomper l’eau avant de pouvoir poser leurs structures… Il ne me restait plus qu’à dire : « Eh bien voilà, c’est ça la réalité, et c’est de ça dont je voulais parler ! Qu’est-ce qu’on fait, maintenant ? »
À partir de là, toute l’organisation de la semaine s’est reconfigurée : il était prévu que l’atelier se déroule à la fac, nous avons décidé que tout se passerait sur le site, et avec les habitants. Nous avons ensuite réexaminé chacun des objectifs qui avaient été définis, et cherché comment les traiter par des moyens plus simples. Ils voulaient faire de l’ombre, on allait planter des arbres fruitiers. Il se trouve que l’un des étudiants travaillait, pour financer ses études, dans une entreprise de paysagistes. C’est quand même fou : on demande à des étudiants de faire ce qu’ils ne savent pas faire, alors que les compétences préexistantes ne sont pas activées ! [il montre quelques images…] Donc le mardi, on s’est mis au boulot : on a commencé par planter des arbres. Les enseignants sont arrivés avec du papier-calque, en disant : « Il faut absolument dessiner les plans, pour savoir où planter les arbres… » Je leur ai dit : « Oui, vous avez raison, il faut dessiner. Comme je m’en vais dimanche, je vous propose donc de dessiner la semaine prochaine. Vous dessinerez le projet après l’avoir fait, pourquoi pas ? » En fait, on s’est rendu compte que comme il y avait dans le sol les restes des dalles en ciment, il n’était pas possible de planter n’importe où, et qu’il fallait donc s’adapter aux contraintes du terrain. La mare d’eau qui stagnait est devenue un bassin, c’est-à-dire que ce qui était un problème technique est devenu un projet. On a trouvé des pavés, on a acheté du ciment, on a fait une bordure pour former le bassin, et toutes les plantes qui étaient déjà-là ont été conservées : c’est un projet ready-made. Puis, j’ai demandé aux étudiants de travailler sur un inventaire des plantes. Nous nous sommes rendu compte que la plupart d’entre elles sont comestibles. Les Indiens les connaissent, et les consomment. Ils les nomment, en reconnaissent le goût, les qualités nutritives et médicinales. Nous avons posé des cartels, et écrit le nom de toutes les plantes que nous avions identifiées… C’est quand même formidable, l’accès à la connaissance !
M.B. : Ce sont des questions qui t’intéressent particulièrement ?
C.H. : Oui, peut-être… Mais j’ai surtout lu Gilles Clément. On pourrait croire que tout ça, c’est du bricolage, que c’est de l’action, au sens réducteur du terme… Comme s’il y avait une position de constructeur d’un côté, et une position d’intellectuel de l’autre. En France, on opère souvent ce genre de clivage. Ici, c’est tout le contraire : nous avons fait appel au monde de l’art, avec Marcel Duchamp et ses ready made, à la botanique, à la pensée de Gilles Clément sur les délaissés… La dimension intellectuelle n’est pas absente de nos actions.
Mais l’aventure ne s’est pas arrêtée là, nous avons trouvé des blocs de béton, que nous avons transformés en assises… Finalement, les habitants voulaient un lieu de réunion publique. Au même moment, un groupe d’étudiants, très enthousiastes, vient me voir en me disant : « Christophe, nous avons trouvé 100 palettes… » Or moi, je déteste les palettes ! C’est vraiment la solution idiote : à chaque fois qu’on ne sait pas quoi faire, eh bien, on va chercher des palettes. Je réponds aux étudiants : « OK, je veux bien que l’on utilise des palettes, puisque vous les avez, mais dans ce cas, on va se donner une règle : hors de question de les poser en vrac, sans compétence, je veux que l’on parvienne à des prestations de la qualité de celles d’un menuisier ou même d’un ébéniste. Nous avons aplani le sol pour obtenir un niveau parfait, puis nous avons pris très exactement les cotes des palettes, et nous nous en sommes servis de structure pour construire cet élément mobilier, que nous avons ensuite habillé de contreplaqué. Et voilà le résultat ! [il montre l’image] Au final, plusieurs gamins sont venus nous demander si on pouvait poser une cornière métallique sur les arêtes, pour qu’ils puissent faire du vélo, du bicross et du skate sur cette « piste ». Le samedi, nous avons fait l’inauguration du parc, et lâché des poissons dans le bassin. Finalement, voilà un projet tout simple, fait en une semaine, mais qui dit beaucoup de choses sur la ville, et sur la manière dont on fait les projets. En termes d’enseignement, c’est fantastique : c’est vraiment l’anti-académisme.
M.B. : On peut penser que, parmi toutes ces personnes qui participent aux actions que tu mènes, il y en a un certain nombre qui va en sortir plus conscient des enjeux de leurs projets ?
C.H. : Je l’espère ! J’espère au moins qu’après ça, ils ne feront plus de panneaux A0. Peut-être pas tous, mais du moins certains… En tout cas, j’ai lu sur leurs visages, entre le lundi et le samedi, une grosse différence : on passe de l’inhibition au plaisir. Voilà… On a fait le tour ?
M.B. : Sans doute pas, mais ce n’est déjà pas mal…
NOTES
1. http://www.christophehutin.com/CH/Workshop_Detroit… html
2.au sein de l’University of Detroit Mercy School of Architecture
3. https ://www.facebook.com/SacramentoKnoxx
4. « Par ailleurs, je souhaitais travailler avec une communauté indienne : les Indiens du Michighan – les Ojibwés –, savent très bien vivre en relation avec la nature. Ils n’ont par exemple, jamais de problème avec l’ours, alors que les chasseurs américains, en treillis et en 4 x 4, se font régulièrement attaquer par les ours. À Détroit, il n’y a plus d’entretien de la végétation, c’est une friche, au sens où l’entend Gilles Clément : on a des délaissés, qui vont devenir des forêts. Je trouvais l’idée que des indiens puissent venir ‘sauver Détroit’ assez belle. J’ai eu de la chance : il y avait, dans le quartier, une communauté indienne d’Ojibwés, et notamment un jeune artiste – Sacramento Knoxx10, qui a été embauché pour documenter le projet en vidéo. J’ai passé la semaine avec lui, il m’a montré la ville, la nuit… »