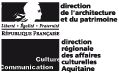Marie Bruneau (M.B.), Bertrand Genier (B.G.) : En 2009, sous le titre Construire librement, l’enseignement de Soweto1, arc en rêve centre d’architecture présentait la recherche que tu avais conduite à Soweto en 2004-2005, en regard avec ton travail d’architecte. C’est d’ailleurs à cette occasion que tu as invité Francis Kéré à venir pour la première fois à Bordeaux.
Revenons aux débuts de l’histoire : comment as-tu commencé avec l’Afrique ?
Christophe Hutin (C.H.) : Je voudrais d’abord préciser que je ne vais pas parler de l’Afrique. Dire l’Afrique, c’est trop vague, et surtout, ça ne permet pas de comprendre la complexité de ce continent… Mon histoire commence par un échec : après le bac, je loupe le concours d’entrée à l’École nationale supérieure maritime, l’école de la marine marchande. J’ai plusieurs mois devant moi, je veux voyager : parmi les différents organismes que j’ai sollicités pour trouver du travail, je reçois une réponse positive de l’ANC2 à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Nous sommes en 1994 ; Mandela vient tout juste d’être élu président de la république, et l’administration sud-africaine est encore très majoritairement aux mains des blancs. Les étudiants et lycéens des milieux progressistes dont le rôle dans la lutte contre l’apartheid a été déterminant, sont organisés en groupes politisés assez performants. Ils publient et distribuent des journaux à 20 000 et 30 000 exemplaires, quasiment sans moyens financiers, c’est-à-dire en faisant tout eux-mêmes, en imprimant sur de vieilles machines, etc. On se doute bien qu’il est hors de question pour les responsables administratifs hérités de l’ancien régime, de financer ces organisations étudiantes qui militent pour des idées opposées aux leurs.
Ma candidature tombe à pic, et elle fait naître l’idée d’adjoindre un jeune blanc français au petit groupe de gens chargés d’aller chercher des financements pour soutenir ces actions. Et l’idée s’est révélée très bonne, car elle contrecarrait radicalement l’argument racial.
À l’époque, je n’étais vraiment pas politisé. Alors, on m’a expliqué et j’ai appris sur le tas, notamment à négocier… Je participais à des réunions dans les campus, les lycées, les instituts de formation professionnelle, les centres d’apprentissage, etc. qui produisaient et animaient soit une radio, soit un journal, soit les deux. Avant chaque rencontre, j’étais briefé : « Tu parleras à tel moment, et quand la question du budget arrivera, tu diras qu’en France, vous donnez tant d’argent dans le même cas de figure, etc. »
M.B. : Où habitais-tu ?
C.H. : J’étais logé à Soweto, dans une maison de trois pièces où nous vivions à sept, avec des militants de l’ANC – qui sont aujourd’hui devenus des cadres de l’État, et n’habitent plus du tout Soweto… À l’époque, nous étions dans des conditions très précaires, et très sympathiques. J’ai vécu là une expérience humaine très forte, mais j’ai pourtant failli repartir dès les tout premiers jours ! En fait, j’étais vraiment victime de racisme, ce qui n’était pas du tout envisageable pour le jeune blanc, français et de bonne famille, que j’étais !
En fait, j’ai vite compris que c’est tout ce que je représentais qui me valait cette hostilité. Petit à petit, on a su que je travaillais avec un tel, que j’habitais avec tel autre, et que je menais une mission, dans le cadre des élections, pour le compte de l’ANC… Je me suis inscrit pour participer à l’équipe de foot du quartier, et on a fini par me trouver très sympathique, à tel point que je suis devenu l’invité incontournable de tous les mariages ! J’ai ainsi acquis une certaine expertise de ce type d’événement : le samedi, on fait la fête, et le lendemain les deux jeunes qui viennent de se marier quittent le domicile familial pour construire leur maison, dans l’un des quartiers dits « informels » de Soweto. J’ai participé à la construction de plusieurs de ces maisons. En général, ce n’est que l’affaire de deux ou trois heures : ensuite, on va chercher quelques meubles, et les jeunes gens aménagent, exactement comme on le fait ici quand on s’installe dans un nouvel appartement. La différence, c’est qu’ils le font dans une maison qui vient tout juste d’être construite, en quelques heures, collectivement et pour eux. Cette expérience m’a profondément marqué. Pourquoi ? Eh bien d’abord parce que c’est humainement très fort, ensuite parce que ce sont des manières de faire que nous ne connaissons pas…
B.G. : En quoi ce premier séjour à Soweto a-t-il été déterminant pour toi ?
C.H. : C’est sans doute là qu’est né mon intérêt pour l’architecture, en découvrant, sur le tas, que notre environnement n’est pas qu’une affaire de constructions, de techniques et d’économie, mais qu’il s’agit vraiment d’un projet de vie et qu’il est d’abord question de se construire soi-même. Et j’ai réalisé qu’on peut contribuer à changer le monde en participant à ce type d’actions infimes, légères… mais essentielles. Voir les gens construire leur maison, spontanément, m’a permis d’approcher un acte très libre, très poétique, et chargé d’un formidable potentiel créatif, dans la mesure où tout reste toujours à inventer. Je me suis aussi bien rendu compte des limites de l’action politique au sens où on la pratiquait alors, et je réalisais que l’acte de construire des maisons, c’était une autre forme d’action politique, concrète, physique, en prise directe avec la réalité et avec les gens. C’est là, précisément, que j’ai vraiment compris que l’avenir des personnes passe par un accès à un logement, c’est-à-dire à la dignité.
Ce qui est intéressant, dans ces moments de constructions « spontanées », c’est l’improvisation… Impossible de planifier, car personne ne connaît les ressources disponibles – on ne sait même pas de combien de clous on va pouvoir disposer : on peut bien compter ceux qu’on a récupérés, mais il va falloir les détordre, certains vont se casser… Alors, on fait avec ce qu’on a. Tout est très limité, et pourtant les résultats sont assez exceptionnels : voilà la grande leçon.
B.G. : C’est donc là que se fonde et s’inscrit ta pratique d’architecte, politiquement et poétiquement ?
C.H. : Mais tout cela, je ne l’ai compris que plus tard ! Dans un premier temps, ce qui m’apparaissait flagrant, c’était l’enthousiasme et le résultat politique – et pratique – immédiat. C’est vraiment cette expérience qui m’a décidé à entreprendre des études d’architecture, en partant d’un raisonnement très simple : ici, il y a tout à faire, et je veux apprendre à tout faire ! Je suis donc entré en première année de l’école d’architecture de Bordeaux. On y apprenait à faire des croquis perspectifs, à imaginer des monuments… Autant de choses qui me semblaient assez inutiles, et surtout qui m’éloignaient du terrain sur lequel je voulais m’engager. Et je pense que sans la rencontre de Jean-Philippe Vassal, qui intervenait alors en première année, j’aurais arrêté immédiatement. Ensuite, chaque année, j’ai changé d’école, ce qui m’a permis de renouveler un peu les approches. J’ai aussi profité du temps de mes études pour aller travailler chez Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal [qui avaient alors leur atelier à Bordeaux], ainsi que chez Jacques Hondelatte…
M.B. : Et après ton diplôme, tu repars en Afrique du Sud…
C.H. : J’ai bénéficié d’une bourse de l’Afaa3 – « L’envers de villes » –, qui permettait à un jeune architecte de partir à l’étranger pour réaliser un travail de recherche. J’avais proposé de retourner à l’endroit même où j’avais vécu en 1994, avec le projet de faire un bilan de l’action sur le logement, dix ans après l’avènement de la démocratie et la mise en place de la politique de Mandela et de l’ANC. Je suis donc resté plusieurs mois là-bas. J’ai débuté ma recherche de façon très académique, avec une approche sociologique partant du haut pour aller vers le bas, et nourrie de chiffres, de statistiques et de moyennes : combien de maisons par quartier ? combien de personnes dans les logements ? etc.
Au bout de quelques mois, j’ai réalisé que j’étais en train d’amasser une matière qui restait très générique, et finalement pas très intéressante… J’ai décidé de tout arrêter, y compris les prises de vue photographiques, car je ne me sentais pas à l’aise avec ça : dans les squatters camps, l’esthétique est fascinante, mais ce n’est pas le propos !
M.B. : Tu parles d’esthétique de la misère, c’est quelque chose dont tu te méfies ?
C.H. : Oui, on est tous fasciné parce que c’est très impressionnant. Mais photographier la misère, c’est mettre la misère en avant, et finalement, ce sont des images très dévalorisantes pour les gens et pour leur culture. Elles ne montrent pas la vie, et elles ne disent rien des actions qui sont menées pour faire bouger les choses. Il fallait donc trouver une autre manière de documenter. Il s’est alors passé deux mois, et je ne voyais toujours pas… jusqu’au moment où j’ai décidé de m’intéresser à une personne, à un individu en particulier, que je suivrais et dont j’essayerai d’enregistrer le quotidien. Plutôt que de prétendre traiter de l’ensemble de la société, le projet était de rendre compte d’un cas précis, avec le plus de justesse possible, comme on ferait de l’anatomie en médecine. J’ai alors rencontré une femme qui construisait sa maison. Elle s’appelle Maria. J’ai fait un documentaire de 50 minutes sur elle et avec elle : un long plan-séquence, filmé dans ma voiture, où elle me parle de sa vie, alors que nous faisons ensemble le chemin entre son travail et sa maison. J’ai aussi filmé le démontage et le remontage de la maison, de face avec un pied, et en longs plans séquences, selon un protocole très strict, ce qui m’a permis de produire le document qui a été exposé à arc en rêve en 20054.
B.G. : Dans ce film, c’est Maria qui parle…
C.H. : Oui, c’est ça. Mon film commence à la sortie de son travail : elle monte dans ma voiture… Quand elle arrive chez elle, le film est fini. Et pendant toute la durée de ce trajet, elle n’arrête pas de parler. Ce qui est très beau, c’est que, chemin faisant, elle commente le paysage, faisant apparaître le lien très fort qu’il y a entre son propos et le contexte dans lequel il s’inscrit. Il y a, partout, des gens comme elles – que j’appelle des « érudits du quotidien » –, et je pense qu’il y aurait un vrai travail à faire avec ces gens-là : ils ont une capacité unique de décrire leur quotidien et de montrer leur environnement, exactement comme l’a fait Maria. On parle souvent des problèmes « en général », mais il serait bien plus intéressant d’aller sur place, de mettre ses mains et ses pieds dans les situations, et de les montrer telles qu’elles sont, à travers des individus comme eux…
B.G. : Repartir du singulier…
C.H. : Exactement. Faire remonter les choses de la base, c’est la seule démarche valable. Il faut arrêter de croire que les solutions vont arriver d’en haut, alors que souvent, les meilleurs viennent de la base. Mandela n’est pas arrivé d’en haut, il n’a pas fait l’ENA…
B.G. : C’est également au cours de cette seconde expérience sud-africaine que tu observes les effets du programme gouvernemental RDP5 ?
C.H. : Oui. Mandela avait lancé un plan quinquennal sur la question du logement, et je voulais en documenter les effets. Ce plan a permis de construire, à la date d’aujourd’hui, trois millions de maisons (ce qui est colossal !), d’une surface de 36 m2 dans les premières versions, et de 43 m2 dans les dernières évolutions du projet. Maisons en briques, avec un toit à deux pentes. Entre la masse d’argent disponible et le nombre de personnes à reloger (plusieurs millions), un simple calcul avait conduit à définir la somme disponible pour la construction de chaque maison : 5.000 €.
Ce programme avait pour objectif premier de transformer les squatter-camps (bidonvilles), et d’éradiquer les maisons en tôle. Mais il s’agissait aussi de relancer le système économique : pour lutter contre l’apartheid, Mandela avait demandé aux habitants de ne plus payer aucun loyer, ni aucune taxe au gouvernement – y compris l’énergie. Difficile, après trente ans de non-droit, de demander à toute une population de se remettre à payer des impôts, uniquement parce que le président est sympa ! Avec le programme RDP, il s’agissait de pouvoir dire : « La terre appartient à tout le monde, donc nous allons vous donner – par acte notarié – la parcelle que vous avez squattée. Sur cette parcelle, nous allons construire, gratuitement, une maison en briques, mais en contrepartie, vous payerez une taxe foncière, et l’accès à l’énergie… »
M.B. : Quel bilan tires-tu de cette action ?
C.H. : Les architectes blancs, et bien-pensants, disent : « Ces maisons, c’est de la m. ! Et d’ailleurs, c’est exactement la même chose que ce que l’on faisait pendant l’apartheid… » Oui, mais pendant l’apartheid, pourquoi n’avoir rien dit ? On ne peut pas comparer la situation actuelle de l’Afrique du Sud avec celle du temps l’apartheid : ça n’a rien à voir. Et surtout, ce genre d’anathème ne prend pas en compte la complexité du contexte.
Pour autant, il faut bien reconnaître que techniquement, ces maisons ne sont pas terribles. L’argument du politique, c’est de dire : « Nous n’avons jamais prétendu faire quelque chose de fini, d’abouti. C’est un embryon, un noyau de vie, un point de départ. En parallèle, nous menons aussi une politique d’emploi, et si tout le système se met à fonctionner, alors les habitants auront un travail, ils pourront contracter des crédits pour améliorer le confort de leur habitation, l’étendre, etc. »
Pour me rendre compte par moi-même, je suis donc allé voir les premières maisons construites, les plus anciennes. Et j’ai constaté qu’effectivement, quand on visite ces premiers quartiers RDP, on ne reconnaît plus du tout la maison d’origine : tout a été transformé, de façon très intelligente et sans architecte. Socialement, le fait d’habiter dans une maison RDP n’est pas très bien vu, parce que cela signifie qu’avant d’accéder à cette maison, son propriétaire vivait dans un shack6. Alors les habitants construisent autour de la maison d’origine, qui se retrouve complètement englobée dans une nouvelle construction, dont elle constitue généralement deux pièces intérieures, la salle de bain et une chambre, par exemple
B.G. : Une maison Latapie7, en quelque sorte ?
C.H. : Exactement ! Pour les plus malins, oui ! C’est bien là qu’Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal ont raison quand ils disent qu’un architecte, avec des petites interventions, peut changer le monde…
Pour la construction de la maison de Maria, je n’étais pas intervenu en tant qu’architecte. De la même façon, l’idée de mon enquête sur ces maisons RDP, c’était de comprendre le processus de construction, d’analyser tout le programme. Alors j’ai suivi les équipes pendant plusieurs semaines, ce qui m’a permis d’en découvrir la complexité et les enjeux cachés. Car il y a toute une série de règles, en apparence techniques mais qui, sont en fait politiques, comme par exemple l’obligation de respecter la parité hommes/femmes sur le chantier, d’embaucher des personnes habitant sur les quartiers, de fabriquer des briques sur site, etc. J’ai donc suivi ces équipes, et c’était passionnant.
M.B. : Comment s’organise l’implantation de ces maisons ? la régulation du parcellaire ?
C.H. : C’est à la fois simple et complexe. Tout se passe sur site : on prend des mesures et on compose avec la complexité de chaque situation. L’orientation, la topographie, les chemins existants, les obstacles, etc., tout compte, tout est pris en compte. C’est vraiment le contraire de la planification : rien n’est fait sur plan, rien n’est tracé en amont, rien n’est composé ou régulé avec une vision d’ensemble. Ce qui importe, ici, c’est le rapport singulier à un terrain, à une parcelle, à des besoins : on s’y prendra différemment pour une famille de douze personnes que pour une famille de deux, par exemple. Tout cela se fait d’une façon spontanée, et totalement improvisée : sur le terrain, les pieds au sol, avec une véritable intelligence de la situation, et une très grande précision.
Quand on part de l’existant, on part de la vie. Dans les programmes RDP, pour intervenir sur un quartier de bidonvilles, il aurait sans doute été plus simple de « nettoyer » : dire aux habitants : « Nous allons vous déplacer dans des logements neufs », et faire de l’urbanisme comme on sait le faire partout dans le monde, avec les outils de la planification. Or, c’est tout le contraire qui a été fait : les décideurs politiques ont accepté d’installer des canalisations de tout-à-l’égout et des réseaux électriques dans des bidonvilles : techniquement et politiquement, c’est plutôt courageux ; il y a là un grand respect des gens et du tissu social. Personne n’est exproprié, on ne démonte pas pour refaire, et les structures sociales sont préservées. Un bidonville, c’est pourtant très précaire, très léger du point de vue du bâti existant. Mais la construction la plus précieuse et la plus difficile à mettre en place est de nature sociale : dans ces quartiers, les gens vivent en communauté, il y a une grande solidarité, et ça, il ne faut pas le démolir car on ne saura pas le remonter. C’est pourtant ce que nous faisons constamment en France… Tous les projets de rénovation urbaine mettent à plat les quartiers : on rase pour refaire, et on demande à des gens issus de l’immigration, qui ont mis des années à s’intégrer, de s’en aller vivre ailleurs. On les oblige à repartir à zéro, ils sont immigrés à nouveau !
NOTES
1. Christophe Hutin, Patrice Goulet, L’enseignement de Soweto, construire librement, Actes Sud, L’impensé, 2008.
2. African National Congress
3. L’Association française d’action artistique (Afaa), devenue ensuite « Culture France », était une association déléguée du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture pour les échanges culturels internationaux et l’aide au développement.
4. arc en rêve centre d’architecture, Township today, installation vidéo/photo de Christophe Hutin, dans le cadre de l’exposition Est-Ouest/Nord-Sud, faire habiter l’homme, là, encore, autrement > séquence # 3, 2005
5. Les programmes de reconstruction et de développement (RDP) ont pour objectif de livrer des logements sociaux sous forme de maison standard qui, selon l’ascension sociale de ses propriétaires, s’agrandira.
6. Les shacks sont de « modestes baraques en bois et tôles qui, sans être un modèle d’habitat, sont le reflet d’un projet réel d’existence et enseignent un rapport à l’acte de bâtir libre et désinhibé » (Christophe Hutin, Patrice Goulet, L’enseignement de Soweto, op. cit.).
7. La maison Latapie est l’une des premières maisons construites par Lacaton & Vassal, pour la famille Latapie, à Cenon, avec un budget de 500.000 francs (75.000 €)