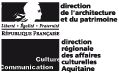Bertrand Genier (B.G.) : Y a-t-il d’autres lieux dans le monde qui vous inspirent particulièrement ?
Jean-Philippe Vassal (J.-P.V.) : Aujourd’hui, avec un grand décalage géographique par rapport à l’Afrique, il y a une situation qui m’intéresse beaucoup, c’est celle de Berlin. J’enseigne là-bas, parce qu’il y a quelque chose, là, que j’ai envie de comprendre. Voilà une ville très pauvre, dans un pays très riche, avec un passé très complexe. Un territoire très étendu. Énormément de vides. Les logements sont deux ou trois fois plus larges qu’ici. Il n’y a pas beaucoup de trafic, ça circule bien, parce qu’il y a tout un réseau de voies ferrées, avec des trains, et on se rend compte qu’il n’y a besoin de beaucoup plus, pas besoin d’investisseurs pour « changer la ville », et que, finalement, cette ville un peu « sauvage », un peu « brute », offre suffisamment de confort de vie… Et on voit très bien comment cette configuration est propice à la liberté : à Berlin, parce qu’il y a plus d’espace, parce que c’est plus simple, chacun est prêt à accepter beaucoup plus de choses de son voisin qu’il n’en accepterait à Paris, et la tolérance est beaucoup plus grande. Mais Berlin change, et les gens commencent à se plaindre : les prix augmentent… Et donc, on se pose des questions. Pour l’instant, les interventions des architectes et des urbanistes sont comme une goutte d’eau dans l’océan, car malgré tout, la ville a une telle qualité qu’elle résiste particulièrement bien, et qu’on y trouve toujours ces vides, ces impressions d’espaces non-finis, infinis, générateurs de possibles, d’aventures. Je pense, précisément, qu’il faudrait pouvoir regarder cette ville, en Europe, comme une situation qui serait peut-être exemplaire, et se demander comment aller vers là, plutôt que d’essayer de faire bouger les choses à l’inverse.
Anne Lacaton (A.L.) : Oui, mais pourtant, depuis la réouverture du mur, on ne peut pas dire qu’ils sont allés dans ce sens, et c’est même le contraire : ils ont fait venir les plus grands architectes et urbanistes, qui, au fond, n’ont fait aucun cas de la particularité de cette ville pour en faire une sorte de catalogue (d’architecture)…
J.-P.V. : C’est tout de même assez incroyable de trouver une ville qui décide, du jour au lendemain, de faire tomber la clôture de l’aéroport1, maintenant désaffecté, en plein centre urbain, et d’y laisser entrer les gens. Voilà quand même une très belle forme de confiance, et d’optimisme ! C’est vrai que maintenant, sous la pression des promoteurs, on est en train de se demander s’il ne faudrait pas vendre quelques terrains, mais malgré tout, depuis maintenant quatre ou cinq ans, des gens ont commencé à construire des petites cabanes, d’autres font des jardins ; l’hiver, ils font du ski de fond sur les pistes…
B.G. : N’est ce pas précisément ce côté inachevé, qui est important ? Et que l’on retrouve aussi dans votre travail ?
J.-P.V. : Oui. L’inachèvement, c’est ce qui laisse ouvert la possibilité d’une continuité : c’est parce que les choses sont inachevées qu’elles peuvent continuer. Une maison, en tant qu’espace de vie, ne peut pas se finir au moment où l’architecte a achevé son travail, puisque, précisément, l’espace ne fonctionne que parce qu’il y a des gens qui courent, qui s’assoient, qui en invitent d’autres, ou qui ont trouvé un endroit d’où on a une très belle vue sur l’extérieur… C’est toujours lié à cette mobilité du corps. Cette idée de toujours laisser aux choses cette possibilité de se transformer, est pour nous fondamentale. C’est le cas pour la maison Latapie, c’est le cas à l’école d’architecture de Nantes, et aussi au palais de Tokyo. Qu’il s’agisse d’une maison, d’une école d’architecture ou d’un centre d’art, ce sont les personnes qui habitent qui prolongent le projet.
A.L. : Ce ne serait peut-être pas tant la notion d’inachevé qui conviendrait ici, que celle d’ouverture. Nous essayons de proposer des systèmes ouverts, en réfléchissant au moment le plus favorable pour mettre un terme à notre contribution de manière à laisser le projet suffisamment ouvert pour que l’histoire puisse continuer sans nous.
Marie Bruneau (M.B.) : Il y a donc une idée de confiance ?
J.-P.V. : Oui, la confiance, c’est par exemple la serre pour la famille Latapie : alors que nous rêvions de bougainvilliers et de palmiers, ils y ont installé leur canapé et leur table, leur armoire…
A.L. : Finalement, ils ont utilisé cet espace avec une plus grande liberté que ce que nous aurions imaginé…
J.-P.V. : Au bout du compte, cette pièce, non chauffée, est la plus utilisée de la maison !
A.L.: Sans doute parce qu’il n’y a pas de modèle, pas de représentation pour cette pièce : il n’y a pas, comme dans une salle à manger, une armoire que l’on ne déplace jamais ; la serre, c’est la pièce dont l’aménagement change le plus souvent, parce que son usage est ouvert…
J.-P.V. : La mobilité est liée à l’espace…
A.L. : Elle est liée aussi au confort climatique. Tu expliquais tout à l’heure que les gens maîtrisent parfaitement les déplacements d’air, et donc se déplacent tout au long d’une journée dans de grands espaces, eh bien, dans une maison, c’est pareil : entre les pièces situées au nord, au sud, les parties ombrées, les espaces situés sous la toiture ou bien en bas, ou en sous-sol, on a des différences de température. Et c’est quand même un très grand luxe et un très grand confort, de pouvoir bouger dans une habitation en ville, parce que ce n’est pas dans les cinquante-cinq mètres carrés d’un T3 que l’on peut faire ça ! C’est cette recherche d’une mobilité en relation avec un confort climatique qui nous a toujours motivés. Et c’est cette recherche qui nous a permis de remettre en question l’idée d’un confort standard, tel qu’il est exigé par la réglementation. Par exemple, il nous semble tout à fait possible d’assumer l’absence de lumière naturelle dans une partie de la maison, parce que l’on sait que, par ailleurs, dans les zones où elle est nécessaire, on a déjà deux fois plus de surface que dans n’importe quel logement standard. Alors le fait d’avoir un espace un peu noir dans une maison devient une qualité – si ce n’est pas partout, bien entendu. Et c’est là que l’on rejoint des objectifs climatiques, et que l’on peut en venir à contester la validité de ces normes dites HQE, qui vont à l’encontre de cette pensée, en exigeant les mêmes normes de confort partout, ce qui revient, de fait, à construire des logements plus petits, pour pouvoir répondre à ces exigences…
J.-P.V. : On en revient ainsi à une maison – ou un appartement – qui a peu de contact avec l’extérieur, c’est-à-dire qu’on ne considère jamais que l’habitation s’étend au-delà des murs, jusqu’où le regard porte depuis les fenêtres. Avec ces normes, on caractérise l’espace par rapport aux cinq jours les pires de l’hiver, et aux cinq jours les pires de l’été. C’est ce qui détermine la quantité de murs, de fenêtres, d’isolants… On se défend par rapport au climat, c’est-à-dire par rapport à dix jours dans l’année, et pendant les trois cent cinquante-cinq jours restants, eh bien, on vit derrière ces défenses, avec ce manteau qui nous a servis quand il faisait très froid (ou très chaud), alors qu’à certains moments, il fait bien meilleur vivre dehors que dedans… Sommes-nous capables de filtrer le climat, de jouer avec lui ? De penser le climat comme l’un des matériaux principaux de la maison que l’on va fabriquer, au lieu de raisonner contre lui, de le laisser dehors ? Si on réfléchit un peu, on voit bien qu’il y a déjà là une économie à faire, en trouvant les moyens d’utiliser le climat au lieu de tout faire pour s’en protéger.
M.B. : Ces considérations entrent en contradiction avec l’idée même de normes ?
A.L. : Oui, d’autant plus que ces normes – et précisément celles qui portent sur le climat et l’économie d’énergie ont très vite amené des solutions de matériaux et d’espace extrêmement banalisés, et qui sont systématiquement fondées sur l’idée de s’isoler de l’extérieur. D’autre part, elles considèrent chaque bâtiment comme un système autonome, et ne tiennent pas compte de la sensibilité de chaque habitant, de sa propre notion de confort. Elles partent du principe que le confort c’est quelque chose que l’on peut mesurer, chiffrer, et non pas quelque chose qui peut être ressenti, avec forcément des différences très importantes entre les différentes personnes. L’habitant ne doit surtout pas intervenir sur ces systèmes, car il risquerait de le perturber : ouvrir une fenêtre, par exemple, devient un geste perturbateur… C’est cela que nous ne pouvons pas accepter, et c’est pourquoi nous avons toujours essayé de prendre le problème à l’envers, en incitant l’habitant à retrouver une part de bon sens que nous avons tous en nous, et qui nous rend capables de comprendre et de manipuler les éléments nous permettant de définir un certain confort.
J.-P.V. : Pour en revenir à l’Afrique, c’est au Niger – dans cette zone qui comprend la partie saharienne et le Sahel – que j’ai pu comprendre physiquement ces questions liées au climat, et comment l’habitat interagit par rapport à ça, en termes de conception. Dans le nord du Niger, par exemple, la température peut monter à 45 ou 50 degrés pendant la journée, et tomber à 5 degrés la nuit. Dans ces conditions, c’est quoi, la maison ? La maison, d’abord, c’est le désert. Mais quand il fait cinq degrés, je m’abrite dans la maison en terre pour avoir chaud : quand le soleil a tapé sur la brique pendant toute la journée, elle fonctionne comme un radiateur. Je suis donc là pour ne pas avoir froid. Or j’ai vu venir là-bas plusieurs occidentaux qui cherchaient à construire des maisons en terre pour se protéger de la chaleur… ce qui est une ânerie : la plupart du temps, les habitants de ces régions sont agriculteurs, ou éleveurs, et vivent dehors toute la journée. On est dans le même schéma de fonctionnement que ceux de l’habitat rural de nos sociétés traditionnelles. Qui a dit que c’est inconfortable ?
M.B.: Un fonctionnement animal : la terre, c’est lié au terrier, au refuge…
A.L. : Oui, un fonctionnement animal, mais qui est surtout intelligent, c’est-à-dire qu’il fait appel à l’intelligence des situations, pour trouver et adapter celle qui convient à chaque moment. Tout le contraire d’un confort normalisé.
J.-P.V. : Au sud du Niger, dans le Sahel, la question se pose très différemment : il fait un peu moins chaud pendant la journée, mais la nuit, il continue à faire 30º. Alors, l’habitation habituelle, c’est la paillote, sous laquelle on peut venir se mettre à l’ombre, et qui n’empêche pas le vent de passer, pour rafraîchir le système. J’ai donc vu venir dans ce pays des gens, avec des idées complètement préconçues sur ces sujets, et faire des prototypes qui ne marchaient pas !
A.L. : Oui, ils s’imaginaient que la construction en terre que l’on fabrique de ses mains convient bien à la population locale, et ils étaient sensibles à l’esthétique qui va avec. C’est pour cela qu’il faut être observateur, et intelligent, avant de formuler toute réponse concrète. Et c’est là, je pense, que les architectes ont de l’avenir !
B.G. : Nous abordons des années où la question des ressources, ainsi que celle de l’évolution du climat vont être au centre de nos préoccupations, et de l’acte de construire…
A.L. : Oui, mais on commence déjà à voir que la façon dont on les aborde aujourd’hui, par le tout normatif, et en excluant complètement le ressenti, la sensibilité, le plaisir… a des limites. Quand on sera arrivé à poser une épaisseur de cinquante centimètres d’isolant, on commencera peut-être à se dire qu’il vaudrait mieux accepter d’avoir quelques degrés en moins à l’intérieur des maisons, et se couvrir un peu plus. Ce qui suppose d’impliquer la responsabilité et la participation de celui qui habite. Car si on doit en arriver là, il faudra trouver des compensations, et notamment proposer des espaces où l’individu est généreusement servi – que ce soit pour l’espace public, pour l’habitation, pour tout. Il n’y a que comme cela que l’on parviendra à rendre les gens actifs sur ces questions-là…
J.-P.V. : Ce qui m’intéresse, en Afrique, par rapport à l’habitat, c’est qu’il est pensé comme un habit. L’été, tu ne portes pas le même habit que l’hiver, pourquoi la maison serait-elle la même ? Pourquoi ne pas imaginer un certain nombre de parois, de rideaux, de filtres qui permettent de configurer cette maison non seulement en fonction des saisons, mais aussi du jour et de la nuit, de la bonne ou mauvaise humeur, ou de ce que l’on a envie de faire et de vivre ? C’est l’addition de toutes ces décisions que l’habitant pourrait prendre par rapport au réglage de son confort et de son plaisir à être dans un espace, qui sera finalement source d’économies d’énergie. À la tour Bois-le-Prêtre, dans les programmes de transformation réalisés dans les années 1980, on a rajouté des façades en amiante-ciment et des fenêtres en PVC sur tous les immeubles. Les systèmes de chauffage ont été laissés tels quels. Les logements, avec ces nouvelles isolations et ces fenêtres étanches, qui laissent passer beaucoup moins de lumière, sont devenus trop performants – plus exactement trop confinés : les gens avaient trop chaud, et donc ils ouvraient les fenêtres. Au bout du compte, ils dépensaient plus qu’avant.
A.L. : Ces logements, plutôt corrects à l’origine, ont ainsi été complètement dégradés par ce programme de transformation : les gens se sont retrouvés avec des petites fenêtres, alors qu’ils avaient des vues fantastiques, et les logements sont devenus sombres ! Devant un tel constat, on peut se demander à quoi sert un travail d’architecture, si ce n’est pas pour améliorer les espaces dans lesquels on vit. C’est quand même là l’essentiel…
B.G. : Il faut donc que l’individu soit généreusement servi, dis-tu. Ne faut-il pas repartir de là, de cette autonomie, ou de cette liberté qu’il s’agirait de retrouver, par rapport à cet état de crise permanente, qu’il faudra bien cesser de nommer crise…
J.-P.V. : Je pense que la liberté, c’est essentiel. Vraiment. C’est bien pour cela qu’il faut ouvrir plus de possibles. Autant sur les moyens, il faut viser le minimum, autant sur les objectifs, il faut viser le maximum. Tout à l’heure, nous parlions des espaces que l’on trouve à Casablanca : à aucun moment, on n’a envie de faire moins bien que cela, et même si on a moins de ressources, il faut continuer à viser cela. Parce qu’il y a une sorte de maximum, qui est nécessaire, et en même temps, ce maximum peut être fait de peu de chose : un minimum de poteaux, de poutres et de planchers suffit pour ouvrir de grands espaces. À partir de là, ce qu’il faut, c’est réfléchir à l’air : comment sera l’air, pour qu’il soit toujours agréable de vivre là ? On peut aussi réfléchir à d’autres qualités. Jacques Hondelatte – une rencontre importante pour nous – disait : « Nous devons faire une architecture qui se définit par des qualités, et non par des fonctions. » Un espace peut être chaud, ou froid, lumineux, brillant même, ou très sombre, humide ou sec… Et finalement, c’est en produisant ces qualités et ces différences qu’on permet à chacun de choisir ce qui lui convient, ce qui n’est pas possible dans les espaces fonctionnels et standards, vers lesquels aujourd’hui on pousse tout le monde à aller. C’est dans cette attention aux qualités de l’espace que l’on rencontre les notions de lumière – avec toutes ses nuances et progressions du plus sombre au plus éclairé –, les notions de volume – des espaces bas, ou haut de plafond, etc.
NOTES
1. Olivier Razemond, L’aéroport transformé en parc urbain, Le Monde, 14/06/2012
et Coralie Lemke, L’ex-aéroport de Tempelhof, nouveau terrain de jeu titanesque des Berlinois, Rue 89_NouvelObs, 01/07/2013