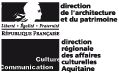Bertrand Genier (B.G.) : Peut-on dire que cette pratique de l’assemblage, décomplexée et sans tabou, se retrouve, par exemple dans la maison Latapie, où vous avez, d’une certaine manière, « assemblé » une serre horticole avec une sorte de boîte en bois ?
Anne Lacaton (A.L.) : Je crois surtout que cette expérience de l’Afrique a ouvert pour nous un chemin de liberté en nous obligeant à réfléchir chaque chose en elle-même, pour essayer de comprendre en quoi elle est agréable, ou belle, en quoi elle pourrait nous servir… et comment se positionner par rapport à elle sans contrainte. Bien entendu, y a forcément des contraintes : une structure, par exemple, doit être stable ! C’est en cela que la liberté se trouve précisément, pour chaque projet, dans la relation à la situation, et dans l’économie du geste, et des choses.
Jean-Philippe Vassal (J.-P.V.) : Oui, c’est la maison Latapie, mais c’est aussi le projet de la Cité manifeste, à Mulhouse, où l’on a une sorte de structure de garage sur lequel on pose une serre professionnelle. On retrouve là les outils les plus efficaces, et les plus performants possibles : la serre horticole pour sa capacité à gérer le climat, et la structure préfabriquée de type parking pour gérer de la surface et du volume. La maison du Cap-Ferret, c’est la même chose, mais la différence, ici, c’est qu’il s’agit de l’interaction entre une forêt et une construction de métal et de béton, qui fabrique une situation. Et la transformation de la tour Bois-le-Prêtre, c’est pareil : il y a un existant, auquel on vient rajouter des choses, plutôt que de démolir et de refaire. Ce qui est très intéressant pour nous, qui ne manquons pas de matériaux, c’est de considérer les situations urbaines comme des matériaux : comment, avec la complexité de la ville, être capable de découvrir des opportunités, et d’en profiter. Et je pense que ce que nous avons fait sur la tour Bois-le-Prêtre se fait déjà depuis 20 ans dans le centre de Johannesburg, en réutilisant les immeubles laissés à la fin de l’apartheid. Vous parlerez de ça avec Christophe Hutin… Si on demandait à ces gens qui vivent à Johannesburg, de venir nous aider dans les banlieues – en essayant d’associer les habitants et de travailler avec eux, plutôt que de les considérer comme des « catégories » passives, ou difficiles à manier –, on s’en sortirait beaucoup mieux !
A.L. : Oui, à condition d’avoir la maîtrise de l’argent qui est dépensé…
M.B. Cette liberté que vous avez découverte en Afrique tient donc à une certaine remise en question des références, y compris esthétiques…
J.-P.V. : Oui, parce que ce qui se produit est le résultat d’un travail un peu intuitif, mais efficace et léger. Il s’agit, à partir du minimum de donner le plus possible. Et dans cette fabrication-là, il y a quelque chose qui se crée tout seul, sans que l’on ait besoin d’y réfléchir, et qui est intéressant.
M.B.: Il suffit donc de recueillir ce surgissement ?
A.L. : Oui, dans la mesure où on accepte la suite, c’est-à-dire que des gens s’en emparent, et en font quelque chose, qui n’est pas toujours ce qu’on avait dans la tête à l’origine, mais qui est toujours quelque chose de bien. Nous nous donnons de la liberté, mais dans le but d’en donner aussi à ceux qui vont utiliser les espaces. Pour revenir à la maison Latapie, il ne s’agit pas d’un exercice de manipulation de matériaux, et la question n’est pas de dépasser le registre des matériaux attendus, ou d’inventer de nouveaux assemblages ; mais fondamentalement, il y a là un propos, une intention, une position extrêmement forte au départ, et en l’occurrence, sur la question du logement, c’est bien celle de vouloir défoncer les standards de l’habitation. Et tout part de là. En fait, pour une maison comme celle des Latapie, si l’objectif n’est pas celui-ci, on n’a pas de raison d’aller chercher tel ou tel système de construction. C’est bien parce qu’à un moment donné nous nous sommes donné l’objectif de faire une maison très spacieuse, ce qui ne correspond pas vraiment aux critères de la petite maison standard, et de le faire avec les moyens de la famille Latapie, qu’il nous a fallu aller chercher des solutions non conventionnelles. Pour la Cité manifeste, à Mulhouse, c’est pareil : l’idée, c’était de sortir des standards étriqués du logement social. Ce sont ces intentions de départ qui restent notre priorité.
B.G. : Cette préoccupation de chercher comment faire plus avec moins, même si elle a pu en agacer certains, est aujourd’hui devenue d’une très grande modernité : nous devons prendre conscience que nous n’aurons jamais plus, et même que nous aurons plutôt moins, et qu’il faudra donc essayer de faire mieux avec moins.
A.L. : Oui. Ou bien que si tu utilises plus, c’est aux dépens de quelque chose, ou de quelqu’un d’autre… En même temps, faire moins cher, ça ne veut pas dire faire moins bien. C’est très positif, c’est très optimiste, comme attitude.
J.-P.V. : Rien n’a jamais montré que ce qui est plus cher est plus beau ! En même temps, cette question-là est subtile, et on peut se faire avoir très vite, avec ce genre de discours. Et notamment par les gens qui disent : « Alors, faisons moins avec moins ! »
A.L. : Oui, c’est très facile de renverser le problème. Après la maison Latapie, par exemple certains pourraient rêver de faire une maison pour le même prix au mètre carré, mais plus petite. Mais ce n’est pas le but. C’est pour cela qu’il faut bien savoir quelle est la position que l’on défend.
J.-P.V. : Cette façon de réfléchir et de se positionner nous aide, parce qu’elle nous place en position de relever un défi. Et c’est cet aiguillon qui stimule notre recherche, qui nous oblige à sortir des sentiers battus, à reconsidérer des réglementations que l’on voudrait nous imposer… Nous nous disons toujours : il n’y a pas de raison que je ne parvienne pas à atteindre des objectifs plus performants que ceux que l’on me donne, mais à condition de pouvoir les gérer avec mes moyens. Pour le Frac Nord Pas-de-Calais, par exemple, on nous avait demandé de faire un bâtiment dans une ancienne halle de réparation de bateaux, et de le remplir de quatre ou cinq niveaux de planchers ; nous avons bien vite compris que si on faisait ça, on allait perdre le vide intérieur qui fait toute la qualité de cet espace. Alors, tout est devenu évident, et l’idée de dupliquer le volume de cette halle s’est imposée. Et au final, c’est bien plus économique, parce qu’il est nettement plus simple de construire à côté que de construire dedans. Au bout du compte, les utilisateurs ont gardé le bénéfice de ce vaste espace demeuré intact, mais il y a peut-être encore quelque chose de plus important, c’est que la mémoire de ces lieux est préservée. Car bien plus que le bâtiment vu de loin, c’est le vide intérieur qui est impressionnant dans cette halle.
Chaque projet contient toujours une sorte de challenge – y compris sur le plan économique – qui pousse à réfléchir davantage. On devrait être payé en fonction du temps que l’on passe à réfléchir, plutôt que sur la quantité des matériaux que l’on met en œuvre, ou leur prix ! Je me souviens, pour le projet de la maison Latapie, du travail considérable qu’il a fallu faire sur le fibrociment pour que les panneaux s’ouvrent et se ferment correctement, etc. À mon sens, un matériau sur lequel il y a eu tout ce temps passé devient, de fait, plus intéressant qu’un marbre posé n’importe comment.
A.L. : On peut aussi avoir le souci de la quantité de matière mise en œuvre. Je me souviens de la belle leçon que nous avons prise, sur cette maison, de la part de l’ingénieur qui calculait les structures. Il nous a un jour demandé – en prenant des précautions parce qu’il ne voulait pas se mêler d’architecture – si nous tenions absolument à employer partout des profils en « H » (c’était notre choix, en référence à la maison Farnsworth de Mies van der Rohe, où poteaux et poutres sont de la même section). Il nous a alors expliqué en quoi ce choix n’était pas du tout intelligent : les profils ne sont pas soumis aux mêmes forces selon qu’ils sont poteau ou poutre, qu’ils soutiennent un plancher ou une toiture… Pourquoi auraient-ils tous le même profil ? On peut être plus direct… Il avait raison !
J.-P.V. : Dans le premier projet, la maison pesait 13 tonnes, dans le second, elle est redescendue à 8 tonnes ! Au prix de l’acier, à l’époque, on a économisé cinquante mille francs. C’était à peu près ce qui manquait pour arriver à boucler le budget.
A.L. : Nous avons eu la chance de tomber sur quelqu’un de très bien ! En termes d’écologie, cette façon d’établir un rapport direct, d’utiliser juste ce que l’on a besoin, et pas plus, c’est la base…
J.-P.V. : Pour le palais de Tokyo, c’est la même chose : à chaque fois qu’on a eu besoin de réduire les coûts, et qu’on a repris une question, simplifié un système technique, le projet a gagné en qualité : on enlevait du superflu…
A.L. : Par exemple, concernant les eaux pluviales, nous avons décidé de faire en sorte que les eaux pluviales aillent toujours au plus direct. Et on a économisé des centaines de mètres de canalisation, par rapport aux plans des ingénieurs. Et pour les câbles électriques, pour les réseaux de ventilation… tout est comme ça. Ce n’est pas obsessionnel, c’est simplement un moyen de ne pas avoir à rogner sur des questions de fond : au palais de Tokyo, quand il fallait rogner, nous n’avons jamais dit : « Eh bien, on va enlever mille mètres carrés », mais nous avons toujours essayé de rogner sur ce qui ne nous semblait pas intéressant, comme les gaines techniques, par exemple. Et on s’est rendu compte qu’en creusant les questions, on pouvait en enlever des quantités de matière. S’il y a de l’argent, on n’a pas besoin de faire ce travail. Et nous en sommes arrivés à ce constat, qui est très paradoxal, mais très vrai : l’économie crée de la liberté.
M.B.: L’Afrique, finalement, vous aurait permis d’exercer votre métier en chercheurs ?
J.-P.V. : Oui, et d’abord parce que c’est plus intéressant de faire comme ça : on a plus de plaisir à chercher, que si on reproduit toujours les mêmes recettes, sur chaque projet. Il y une forme de continuité dans notre travail, mais en même temps, nous nous reposons les questions, systématiquement.
A.L. : Oui, c’est ce qui nous permet de pousser le bouchon toujours un peu plus loin. Je pense que l’Afrique nous a posé une question fondamentale : « Au fond, qu’est-ce c’est, que de faire de l’architecture ? » Je me demande bien si, dans mes études d’architecture, c’est une question que je m’étais posée, au fond. Je ne crois pas. En Afrique, celui qui n’a pas grand-chose a besoin de se faire un abri. Il cherche des morceaux de bois, et il comprend très vite qu’en faisant un trépied, ça tient tout seul, et que s’il met un manteau dessus, ça lui fait un parasol. Au début, tu considères tout ça comme assez dérisoire – « Ce sont des pauvres » –, mais au bout d’un moment, tu comprends que cet homme fait de l’architecture, tous les jours : il passe d’une situation où il lui est impossible de rester à l’endroit où il est parce qu’il y a trop de soleil, ou que c’est inconfortable, à une situation où il a créé un espace habitable. Partant de là, tu commences à comprendre que faire de l’architecture, c’est régler ces questions-là. Avec, bien entendu, une plus grande complexité que celle du parasol, mais, fondamentalement, le propos est le même. Et peut-être avons-nous retenu de l’Afrique la volonté de garder toujours en vue cette légèreté de l’objectif, et l’idée qu’il n’y a pas de raison que ces processus deviennent pesants.
J.-P.V. : Je me souviens d’une des premières conférences à arc en rêve, qui m’a beaucoup marquée : celle d’Emilio Ambaz. Il avait dit : « Si la nature était parfaite, on n’aurait pas besoin de faire de maisons. Les arbres donneraient suffisamment d’ombre, les feuilles permettraient à l’eau de couler tout en protégeant les gens qui sont dessous, etc. » On peut donc se dire que faire de l’architecture, c’est simplement rajouter ce petit peu qui est nécessaire. En Afrique, c’était ça : je me rappelle avoir passé plusieurs jours dans un campement de nomades touaregs – ils étaient à peu près trois cents personnes installées en plein désert. Nous étions une vingtaine de personnes étrangères au campement. Et nous passions la journée à bouger d’un endroit à l’autre : à telle heure, on était sous tel buisson, un peu plus tard, on faisait cent mètres de plus et on s’installait sous un arbre… Et à chaque fois, il faisait bon, et frais, alors que nous étions en plein soleil. Tout était très calme. Certains faisaient de la musique. Il y avait très peu de paroles, sans doute parce que c’était déjà fantastique, d’être là… J’avais remarqué que l’un de mes compagnons restait silencieux. À la fin de la journée, cet homme s’est mis à me parler, dans un français impeccable. Il m’explique qu’il a fait ses études de vétérinaire en France, puis travaillé quelque temps à Paris. Et quand je lui ai demandé pour quelle raison il était revenu vivre ici, il m’a répondu : « Là, sous les étoiles, c’est la plus belle maison qui puisse exister. » Finalement, on n’a pas besoin de grand-chose pour être très bien…