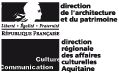Marie Bruneau (M.B.) : Quelle est votre histoire avec l’Afrique ?
Jean-Philippe Vassal (J.-P.V.) : Pour moi, il y en a deux. La première date de mon enfance : jusqu’à 12 ans, j’ai vécu à Casablanca. C’est une ville très marquante, du point de vue de l’architecture : une ville ouverte sur la mer, avec des constructions très modernes.
Anne Lacaton (A.L.) : C’est une ville qui a fait le pari de la modernité, à une époque où elle était refusée partout…
J.-P.V. : En y revenant, bien plus tard, avec Anne, je me suis rendu compte que c’est aussi une ville qui fonctionne extrêmement bien. Même si elle s’est énormément développée, même si l’architecture qui se fait aujourd’hui n’a pas la qualité de celle des années trente ou cinquante, c’est une ville moderne, dynamique – très différente de ce qu’est le reste du Maroc –, et qui offre un confort d’habitation remarquable. Il y a une forme d’optimisme, là-bas, qui finit par produire une ville dans laquelle les gens se sentent bien. Et même quand il y a beaucoup plus de voitures, beaucoup plus de trafic, ça continue à fonctionner. En contrepoint, Casablanca met en évidence tout ce qui ne marche pas bien ici, en France, tout ce qui est restreint, étriqué, serré, contraint, où on ne prend jamais aucun risque.
Bertrand Genier (B.G.) : C’est donc une idée de la modernité que l’on peut défendre ?
J.-P.V. : Disons plutôt qu’on peut, à Casablanca, faire le tri entre ce qui est bien et de ce qui ne l’est pas. Quand le style international s’applique sur une sorte de tabula rasa, c’est scandaleux, mais un style international qui saurait prendre en compte tout ce qui existe déjà, et être attentif à garder tout ce qui est bien pour venir travailler sur ce contraste entre une histoire, un passé, une ville déjà existante et de nouveaux espaces de vie, c’est quelque chose de fantastique. En France, on retrouve un peu ça dans quelques villes, comme Le Havre, ou Royan, Saint-Nazaire peut-être… On voit bien qu’il y a là des espaces pour vivre qui ne sont pas compliqués, pas chers, et qui offrent des qualités fantastiques.
A.L. : L’architecture, à ce moment-là, a basculé vers une autre façon de construire. Et même si aujourd’hui, on peut remettre certaines choses en question, c’est ce basculement qui nous intéresse. Ce qui n’empêche pas d’être quand même très lucide sur les dérives qui se sont produites, notamment quand l’architecte ou l’urbaniste dépassent leurs rôles, et se prennent pour autre chose que ce qu’ils devraient être.
J.-P.V. : C’est un renversement : contrairement à ce qui se faisait jusqu’alors, l’architecture de ces années-là considère l’espace intérieur avant l’espace extérieur. Et l’image du bâtiment est le produit, la conséquence de la qualité de l’espace donné à chaque habitant, à chaque famille, à chaque étage. C’est l’idée, finalement, d’un non-monument fait de générosité, de facilité, d’aisance, de confort, d’optimisme, et qui travaille avec le climat, avec la lumière. Et on peut se dire qu’ici, en Europe, nous sommes passés à côté de tout ça… Plus tard, on a retrouvé cette manière de faire à Buenos Aires, par exemple, et aussi à Alger, à Dakar. On a l’impression qu’ici, en France, on est resté dans quelque chose qui est devenu…
M.B. : Formaliste ?
A.L. : L’abandon du modernisme vient de là : c’est parce qu’on a voulu remplacer un système formel par d’autres systèmes formels, sans comprendre ce que l’on pouvait garder. C’est précisément cela qui nous intéresse : continuer et réinventer à partir de cette histoire-là, en ayant conscience qu’aujourd’hui, bien sûr, les questions ne sont pas les mêmes. Mais néanmoins, il y a des manières de faire qui peuvent nous intéresser et que l’on peut aussi additionner avec d’autres, dans l’histoire. À Casablanca, on a l’impression qu’il y a une vraie légèreté à utiliser les espaces, les matériaux, etc. sans se poser la question de la forme. Et ça, c’est intéressant.
M.B. : D’où l’idée de suivre la piste : puisqu’elle a été ouverte, on peut la continuer ?
A.L. : Oui, ou bien la réorienter : on fait avec ce qui est, et puis on transforme.
B.G. : À la question : c’est quoi, pour toi, l’Afrique, tu me réponds : Casablanca et la modernité…
J.-P.V. : Oui, et on va encore parler de modernité à propos de ma seconde expérience, qui est très différente, puisqu’elle s’est passée pour moi après l’école : le jour même de mon diplôme – en décembre 1979 –, je suis parti pour le Niger, et j’y ai passé cinq ans. Anne est venue me voir souvent. Ici, en Afrique subsaharienne, à la limite du désert, tout est très différent du Maroc et de l’Afrique du Nord. C’est une Afrique que je ne connaissais pas ; très peu de végétation, on voit beaucoup le sol, il y a une sorte de radicalité des choses : le ciel, la ligne d’horizon… Et, j’ai trouvé là une vraie modernité dans les esprits. À partir du moment où les gens sont capables de marier de la tôle ondulée, des fers, des branches, de la paille, un sol en sable… et d’utiliser tout ça pour construire une maison, ou bien d’utiliser des pièces de maison pour réparer des voitures, de récupérer les petits ressorts de montre pour en faire autre chose… bref, de brouiller les provenances, d’être capable de penser : « Ce n’est pas parce que ça provient d’un frigo que je ne peux pas l’utiliser pour réparer ma voiture… », nous sommes devant une inventivité qui est d’une modernité fantastique. À partir de zéro ressource, et dans des horizons ouverts à l’infini, au milieu desquels la moindre verticale – être humain, arbre, etc. –, prend une valeur très forte. Avec cette idée du nomadisme qui considère le désert, l’espace, comme un habitat, et qui ne réduit pas l’habitation à la hutte ou à la paillote. La maison, c’est l’endroit où l’on peut être à l’ombre, à un moment donné – ou bien celui où l’on va se réchauffer, car il fait très froid la nuit en plein désert. Certaines personnes bien intentionnées venaient d’Europe pour expliquer comment construire en terre, faisaient des prototypes de maisons… qui ne fonctionnaient jamais, parce qu’ils coûtaient dix fois plus cher que celles que les gens pouvaient construire avec des bouts de bois et des bouts de tôle.
M.B. : Quand tu parles de ça, tu retrouves cet optimisme, cette insouciance…
A.L. : Oui, l’optimisme ! Et je trouve que ce qui est vraiment fort, aussi, c’est une sorte de curiosité des choses, sans a priori. On ne se pose pas la question de savoir ce qui est correct et ce qui ne l’est pas. Si ça nous intéresse, on prend et on en fait quelque chose, avec intelligence, avec bon sens, et pourquoi pas avec poésie et art, dans les façons d’assembler les choses. Quand tu suis un cursus dans les écoles d’architecture françaises, ou même européennes, tu en sors avec des idées assez « carrées ». L’Afrique nous amène à reconsidérer ce que l’on sait – ou ce que l’on croit savoir –, et à le critiquer.
B.G. : Une leçon de modestie ?
A.L. : Non, ce n’est pas de la modestie, c’est plutôt un énorme élargissement. C’est une capacité à fabriquer, quelle que soit la situation. C’est l’intelligence des situations. C’est la propension à comprendre une question avant de formuler une réponse, et la faculté de prendre son temps pour le faire. C’est, finalement, la capacité de mettre à plat les conventions, notamment à propos de l’architecture. Jean-Philippe parlait des paysages, et constate qu’on habite le désert : cette capacité des gens à se créer un espace privé qui ne soit pas « contenu », pas clos, voilà quelque chose de très fort, qui renvoie à la question du mur, et qui pose les questions de relation, de distance. La plupart du temps, les gens n’ont pas de maison. Je me souviens d’un gars qui ne possédait qu’un lit, et qui rangeait sa valise sous le lit. Laquelle valise contenait tout ce qui lui appartenait. C’était un homme très sympathique, très affable. Mais quand il se mettait sur son lit, il était clair qu’il n’entendait rien d’autre. Pourtant, il n’y avait aucun mur, aucune cloison, aucune barrière, rien. Mais quand il sortait sa valise, qu’il la posait sur son lit et qu’il fouillait dans ses affaires, il ne fallait pas lui parler, c’était très clair. C’est quand même très fort, et ça nous renvoie à notre propre façon de considérer les choses, qui se réfère à une sorte de convention : qu’est-ce qui est « correct », qu’est-ce qui ne l’est pas ? Ce sont des gens libres !
J.-P.V. : D’abord parce qu’en Afrique de l’Ouest – à la différence de l’Afrique du Sud –, n’y a pratiquement pas de clôtures… Quand tu sors de la ville, il n’y a pas de route : tu peux prendre n’importe quelle trace de pas, pour essayer de voir où ça va t’amener ; de toute façon, tu rencontreras quelqu’un qui te dira : « Il faut aller vers là », et ainsi de suite. Voilà une forme de liberté assez incroyable, je trouve ! Liberté, mobilité, nomadisme, voilà trois choses qui m’ont beaucoup frappé, au Niger. L’idée, c’est vraiment d’utiliser tout l’espace, et la maison, c’est comme un vêtement, que tu emportes avec toi, et que tu poses ici, ou ailleurs, en fonction de tes besoins.
M.B. Plutôt une pensée de l’assemblage que l’idée d’une création ex nihilo ?
J.-P.V. : Oui. Et ça me rappelle mon grand-père qui vivait à la campagne. À certains moments, on sentait qu’il allait faire quelque chose ; alors, il regardait autour de lui avec quoi il allait bien pouvoir le faire. Et il cherchait, il ouvrait un tiroir… Au bout d’un moment, il avait rassemblé sept ou huit éléments qui lui paraissaient pouvoir fonctionner ensemble. Il n’avait aucun a priori, ni sur la provenance du matériau ou des objets, ni sur leur caractère plus ou moins esthétique. En Afrique, c’est pareil ; mais comme les moyens sont limités, tu es obligé de trouver l’assemblage particulier, judicieux, intelligent, adapté… Par exemple, pour faire cette petite baraque, sur le marché, dans laquelle le boucher va pouvoir vendre sa viande tous les matins, tu dois forcément trouver quelques bouts de bois. Et pour les assembler, tu commences par enfoncer un clou. Mais un clou tout seul, ça ne suffit pas : ça tourne. Il faut donc bloquer le système, et pour cela il faudrait une rondelle… La rondelle, ça va être une capsule de Coca, forcément : tu cloues à travers la capsule de Coca, et hop, ça bloque le truc. Un autre exemple ? Si tu veux te faire un attaché-case, tu peux te servir de tôle ondulée. Mais la tôle ondulée, ce n’est pas très cool : précisément parce qu’elle est ondulée, ça prend de la place ; donc il faut d’abord la dé-onduler. Alors, tu la dé-ondules, et ensuite, tu te fais ta mallette de vrai businessman ! Et ça, c’est tous les jours, c’est à chaque minute que tu rencontres quelqu’un qui fait un truc comme ça, et à chaque minute, tu es étonné…