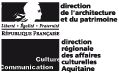Michel Lussault (M.L.) : Nous clôturons cette journée consacrée à la ville africaine, ou plutôt, comme vous avez pu le constater, aux différents « cas urbains », que l’on peut rencontrer aujourd’hui en Afrique, par une conversation que je vais avoir le plaisir de partager avec Francis Kéré, à partir de l’exposition consacrée, en ce moment même, par arc en rêve à son travail. Cette exposition connaît un succès considérable et bénéficie d’une remarquable couverture de presse, non seulement à Bordeaux, mais aussi en France et à l’étranger. Certaines des expositions présentées dans un centre comme celui d’arc en rêve apparaissent, après coup, comme souhaitables ; d’autres comme importantes, mais en voyant l’exposition de Francis Kéré, je me suis dit que celle-là était indispensable. Indispensable, en ce sens qu’elle pose, à travers une pratique (somme toute assez jeune encore : ça fait à peu près une quinzaine d’années que Francis construit) des questions qui dépassent de loin le cadre de l’architecture. En fait, elle interroge l’urbanité contemporaine de ce moment particulier que nous vivons, fait d’une urbanisation généralisée dont la puissance, manifeste, semble aussi s’accompagner d’une grande fragilité. Et justement, c’est la problématique de la fragilité, de la vulnérabilité, du caractère non irréversible et non définitif de l’architecture qui me parait au cœur du travail de Francis Kéré. Cette exposition met surtout en avant une interrogation fondamentale sur les pratiques habitantes de ce début de siècle. Au bout du compte c’est véritablement le problème du rapport des individus et des habitants aux formes, rapport à la fois pratique, actif et sensible aux formes construites que cette exposition met en exergue.
Je voudrais commencer par la lecture d’une phrase de Francis Kéré inscrite sur une des cimaises de l’exposition : « Mon objectif est de jeter un pont entre l’Afrique et les pays développés, où finalement, bâtir selon des critères de durabilité se révèle être un point commun ». Nous pourrions partir de cette idée du « bâtir » comme point commun, qui me semble un très bon résumé. Très souvent, lorsqu’on expose des pratiques architecturales que l’on présente comme « des cas », en particulier en Afrique ou en Asie, on met en avant quelque chose qui peut confiner à l’exotisme, ou au discours de la singularité absolue. Ce que je trouve très frappant dans cette exposition c’est son point de départ : finalement, où que nous soyons, nous avons quelque chose en commun, c’est le fait de bâtir. Et nous allons parfois très loin, alors même que la solution peut être recherchée beaucoup plus prêt qu’on ne le pense. Je voudrais commencer, Francis, par vous poser la question de cette communauté que vous mettez en avant, entre le bâtir au Burkina et le bâtir partout ailleurs dans le monde. Je crois que c’est une ligne directrice de votre travail…
Francis Kéré (F.K.) : Je voudrais d’abord remercier arc en rêve de m’avoir invité ce soir. Je n’ai pas vraiment l’habitude de parler de mon travail : je compte sur vos questions pour me réveiller, et m’amener à partager avec vous ce que je continue de faire avec passion. À propos de ma façon de travailler avec la communauté, je voudrais vous confier un secret : quand j’ai commencé à construire je n’ai pas réfléchi a priori autour de ce j’étais en train de faire : c’était une nécessité, simplement liée à deux éléments fondamentaux : un budget très réduit, et une communauté très forte… Dans un village au Burkina, si vous construisez votre case tout seul, c’est bien : ça montre que vous avez la force et les moyens. Mais sachez que plus tard vous serez considéré comme le plus gros égoïste de cette communauté. Alors que faut-il faire ? Il faut travailler ensemble. Ça permet d’économiser mais aussi ça renforce les liens de la communauté. J’ai commencé de la sorte, pour des raisons économiques. Plus tard, après avoir échangé avec des plusieurs personnes, je me suis dit : « Sois un peu intelligent, racontes que tu as voulu impliquer la population parce que c’est l’avenir… Et ça marche ! » (rires)
M.L. : Fin de la conversation ! (rires)
F.K. : Certains croient qu’on peut tout réfléchir, qu’on peut s’asseoir, tout mettre sur un papier, et puis se dire : Maintenant, c’est cela que nous allons suivre… Non, je pense que construire, surtout dans une région comme l’Afrique où il manque des techniciens, des chercheurs, c’est un processus. Travailler avec la communauté, apprendre à dialoguer, c’est un processus très lent, très long… J’ai eu la chance d’avoir été obligé de suivre cette voie, et d’avoir appris à créer ce processus. Mais nous savons aujourd’hui que nul ne peut subsister sans la communauté, surtout en Afrique. Voilà le centre de mon projet. Quand au reste, tout ce qui est d’ordre intellectuel, je l’ai découvert plus tard. Car ce sont d’abord des idées pratiques qui ont conduit ce travail : ainsi, par exemple, s’il était important pour moi d’impliquer la population dans le processus de construction, c’est tout simplement pour permettre aux membres de la communauté de maintenir dans le temps les bâtiments que nous avons construit ensemble…
Est-ce un peu ce genre de choses que tu voulais entendre ?
M.L. : Oui, oui, c’est très bien. Mais je ne vais pas m’avouer vaincu tout de suite, car que je soupçonne Francis d’avoir plus d’a priori – au bon sens du terme – qu’il ne veut bien le dire. Néanmoins, ce qui est vrai c’est que l’engagement dans le métier d’architecte a précédé pour vous (pour toi ?) le diplôme. Hier soir, tu m’as raconté avoir commencé à construire à partir d’une formation initiale de charpentier, avant même l’obtention de ton diplôme en Allemagne, et poussé par la nécessité de considérer l’architecture d’abord comme une pratique concrète : il fallait réaliser coûte que coûte, c’est bien ça ?
F.K. : Oui, c’est exact. J’ai d’abord passé cinq ans à Berlin dans un cours du soir, pour obtenir le baccalauréat. Et puis, après une première année à l’université, je me suis rendu compte que tout ce que j’avais appris pouvait déjà me servir. Savoir faire un mur droit, par exemple, c’est une chose qui peut servir dans un village ! Après deux ans, je me suis demandé : « Qui va bien pouvoir m’engager à la fin de mes études d’architecte ? » À l’époque, il y avait moins de cinquante architectes au Burkina Faso. De toutes les façons, je ne comptais pas être engagé comme architecte en Allemagne… En même temps, je me demandais : « Comment construisait-on, autour de Berlin, avant notre ère – avant ce temps-là qui est le nôtre aujourd’hui ? » C’est ainsi que j’ai découvert qu’ici aussi, on utilisait la terre pour en faire des briques. Je suis alors compte qu’en Allemagne, c’est la même chose qu’en Afrique : si vous vous asseyez à côté d’un vieux, et s’il sent que vous êtes intéressé et que vous avez le temps pour l’écouter, il va vous raconter beaucoup de choses.
C’est ainsi qu’en Allemagne plusieurs artisans, des hommes simples, m’ont appris beaucoup de choses. Ils m’ont envoyé dans des sites de terre, m’ont fait découvrir des carrières… Alors je me suis dit : « Si tu connais ça, tu dois essayer de le mettre en pratique ! ». C’est ainsi que j’ai commencé, bien avant le diplôme, à faire des projets, à construire. Mes copains d’université me trouvaient courageux. Au début c’était un jeu… On m’a demandé d’aller à Versailles. Mais pourquoi étudier Versailles, même si c’est très beau ? Je ne saurai de toute façon pas comment expliquer à la population de Gando l’existence d’un roi si puissant qu’il a fait créer des cours d’eau et aménager un parc gigantesque, simplement pour le plaisir… Alors on m’a dit : « Il faut aller à New York ! » Mais qu’irais-je faire à New York ? Pour retourner au village, et dire à mon vieux père qu’il y a un bâtiment plus haut que la distance qui sépare son village du village voisin ? Il aurait dit : « Je savais déjà que Francis ment quelquefois, mais je n’aurais jamais pu imaginer qu’il ait le courage de mentir de la sorte ! »
À la place de ces voyages, j’ai demandé qu’on me laisse aller au village pour voir ce que je pourrais construire avec de la terre : « On verra si c’est aussi haut que les tours jumelles de New York… Et si j’arrive à collecter de l’eau et à faire pousser des arbres (aujourd’hui je fais pousser des manguiers à Gando), on verra si ce parc devient aussi beau que celui de Versailles ; en tout cas on l’aura fait ensemble ! » Voilà comment j’ai commencé à construire. Quand ils ont compris que je parlais sérieusement, aucun de mes professeurs n’a voulu signer les papiers : « Attends d’avoir passé ton diplôme ! » Je ne leur en ai pas voulu, car ils ne connaissaient pas ma réalité. Je ne pouvais pas attendre, je ne pouvais pas me permettre le luxe d’attendre avant de construire…
M.L. : Comme il y a des étudiants, dans la salle, ainsi que le directeur de l’école d’architecture de Bordeaux, je tiens à dire que l’exemple que tu donnes là n’est peut-être pas généralisable… En tout cas, il est intéressant ! Je voudrais revenir sur cette double question que tu évoques en permanence, à la fois dans tes travaux et dans tes interventions (Francis Kéré intervient beaucoup aujourd’hui comme enseignant, comme pédagogue au sens fort du terme, dans différentes écoles d’architecture du monde entier…) : d’une part l’importance pour toi d’une interrogation sur les techniques, qui n’est pas théorique et abstraite, mais effective et destinée à trouver des solutions, et d’autre part ce que j’appellerais un sens aigu de la localité, du lieu où l’architecture doit prendre place. J’ai l’impression que ces deux interrogations sont très liées pour toi. Ce qui est frappant – et d’autant plus quand on est comme toi un architecte qui connaît une notoriété fulgurante et reçoit désormais des propositions d’un peu partout dans le monde… –, c’est ton engagement dans l’acte de construire comme un acte qui lie indissociablement un lieu particulier et des techniques particulières, un acte qui exige une immersion de l’architecte dans cette localité pour comprendre ce que certains pourraient désigner comme l’esprit particulier d’un lieu, et les techniques spécifiques qu’il appelle.
F.K. : Aujourd’hui, dans mon village de 5 000 d’habitants, il y a peut-être encore 90 % d’analphabètes, mais quand j’ai commencé, il y en avait plus de 99 %. En fait, j’étais l’un des premiers à avoir eu la chance d’aller à l’école. Comment expliquer à une population qui ne sait ni lire ni écrire, des plans ou des concepts architecturaux ? Évidemment, quand j’ai commencé, il m’a fallu tout découvrir, tout réinventer. C’était là mon point de départ : il fallait aller sur le terrain, aller à la recherche, à la découverte, et il fallait communiquer, expliquer pourquoi faire différemment, en utilisant ce que l’on avait en plus grande quantité, sur place. Voilà pourquoi c’est avec de la terre que nous avons commencé. Aujourd’hui, mon travail est mieux connu, et quand je suis consulté, les gens pensent : « Il travaille avec le lieu, donc il va faire des propositions en rapport avec le lieu… » Et je suis heureux de cela. Pourtant au début, à Gando, personne ne voulait entendre parler de terre : on considérait, comme dans beaucoup de pays d’ailleurs, que la terre n’apporte pas l’innovation. Une maison de terre a besoin d’être réparée chaque année après les saisons de pluie, ce qui demande beaucoup de travail. Pourquoi se fatiguer si on peut avoir une maison en béton, ou en pierre ? Quand je suis arrivé avec ma proposition de construire en terre, la famille n’était pas du tout d’accord, vous pouvez me croire ! Cette idée, a été attribuée « aux Allemands, qui inventent les véhicules les plus rapides, et les plus performants, mais qui parlent, quand il s’agit d’Afrique, de solutions alternatives ! » On disait, à mon propos : « Francis est parti, on sait qu’il est engagé, mais pourquoi se laisse-t-il entraîner par ces Allemands ? Pourquoi ignore-t-il notre réalité ? » Car leur réalité, c’est qu’une petite maison en terre ne résiste pas à la saison des pluies… « Il arrive ici, il prétend construire une école pour plus de 300 élèves et il nous parle de terre ? » Refus complet ! Vous voyez, ce n’est pas seulement une belle histoire, c’est, comme je vous le disais tout à l’heure, un processus. Il y eut un débat. Je ne suis pas un fanatique qui défend la terre à tout prix ; mais je dis simplement qu’il serait irresponsable d’utiliser d’autres matériaux, si on veut travailler sur place, avec un budget très réduit, en Afrique, dans un village du Burkina Faso où nous avons l’électricité la plus chère au monde, où chaque jour on coupe les forêts pour faire la cuisine… Pardon, ce ne serait peut-être pas irresponsable, mais je pense qu’il est plus adapté d’utiliser les matériaux que l’on trouve sur place, tels que la terre, et d’essayer de trouver des alternatives pour économiser, et réduire le coût consacré à d’autres matériaux comme le béton. J’ai donc expliqué pourquoi fallait utiliser la terre… Mais toutes les bonnes théories ça ne suffit pas ! D’abord parce que les gens ne peuvent pas lire, et aussi parce qu’ils veulent voir du concret. J’ai donc passé beaucoup temps à faire des tests – je continue d’ailleurs toujours à faire de la recherche. Il a fallu faire une maquette et la livrer aux intempéries – plus particulièrement à la pluie, puis attendre de voir comment le matériau évolue, avant de songer à mettre quoi que soit en œuvre… C’est donc la nécessité qui m’a conduit à développer cette pratique en relation avec le lieu.
M.L. : Travailler avec le lieu, travailler aussi avec les habitants du lieu, parce que, tu viens de le dire, l’un des postulats de ta démarche, et l’une des raisons pour lesquelles tu tiens à impliquer les habitants dans ce que tu leur proposes, c’est qu’ils ont besoin d’un rapport concret à la forme. C’est-à-dire que ton travail passe par des phases d’abstraction – j’allais dire classiques dans la pratique de l’architecte – mais surtout, qu’il est d’abord fondé sur la volonté de mettre les habitants en situation concrète d’expérimentation, par rapport à ce que tu vas pouvoir leur proposer. C’est cela ?
F.K. : Oui absolument. Et c’est indispensable dans une communauté qui n’a pas l’expérience de l’ingénieur, l’expérience de la technologie. Il faut prouver, il faut faire le concret !
M.L. : On revient à ta phrase initiale sur la communauté des questions, entre toutes les sociétés, autour du bâtir… J’ai l’impression que tu serais prêt à dire que l’un des problèmes d’une certaine architecture ou d’une certaine manière de construire les formes urbaines standards, à l’occidentale, est justement qu’elle se prive de placer les habitants en situation concrète d’appréhender ce qui va être leur expérience du lieu qui va être construit ?
F.K. : Absolument. Je crois que c’est important de revoir tout cela. Je ne sais pas comment l’exprimer, je ne sais même pas si vous me comprenez très bien. Avant – et ce n’est pas du romantisme –, j’avais le temps de m’asseoir sur l’arbre, je buvais le dolo (c’est la bière locale), avec mon père, et je faisais tout pour le convaincre. Maintenant, je passe la plupart de mon temps dans les avions ou les hôtels… La conséquence, c’est que je n’arrive pas à récupérer vraiment ; c’est la raison pour laquelle je ne sais pas si vous m’entendez bien… Je ne voudrais pas accuser les médias, ni les chercheurs, mais si vous vous rendez quelque part en Afrique pour très peu de temps, en prétendant y faire des recherches, vous ne pourrez percevoir qu’une partie de la réalité, et ce que vous allez livrer à l’Europe ne sera qu’une toute petite image superficielle…
Nous, Africains, quand nous venons chez vous et que nous voyons ces belles maisons, ces bâtisses de verre et de métal, nous souhaitons avoir les mêmes, car nous croyons que c’est ça la solution utile. Pour nous, l’Occident est très attractif. Quel que soit ce que vous faites, nous croyons que c’est ce qu’il nous faut – ce qui, bien souvent, nous a entraînés à ne pas trop nous poser de questions. Aujourd’hui nous avons appris que nous sommes nous-même une source.
Nous, architectes, nous devons avoir le courage de dire non. Et c’est très difficile. Combien de gens ne trouvent pas ce courage ? Comparez notre façon de vivre à celle d’un troupeau de moutons qui broute dans un pâturage : il y a toute la masse qui va devant… Qui produit de l’énergie rejette des déchets. Et ça broute… Et vous, derrière, vous suivez… Si nous continuons à suivre comme ça, je ne dirai pas que ce que nous allons trouver, c’est de la m…, mais que ce que nous pourrons faire ne sera pas intéressant, car les autres auront déjà tout découvert. Si vous avez le courage de dire « Non, je fais demi-tour, tout seul… » vous trouverez peut-être un pâturage avec de l’herbe fraîche… C’est ce que j’ai essayé de faire avec mon projet à Gando. (applaudissements)
Il y a quelques années, on disait de moi : « Ce que fait Kéré, ce n’est pas de l’architecture, c’est de la recherche. » Effectivement, j’ai fait celà sans m’en rendre compte, et j’en tire une certaine fierté : nous devons avoir le courage de la recherche.
M.L. : Justement je voulais te demander de poursuivre dans cette voie. Ce que tu proposes n’est pas un mouvement de réaction – que l’on pourrait qualifier de réactionnaire – par rapport aux techniques constructives, aux idées architecturales et urbaines promues comme standards en Occident, qui ne conviendraient pas pour le Burkina… Ton approche, c’est d’essayer de conjuguer une capacité à se délester d’a priori architecturaux – ceux de l’architecture standard contemporaine – et de miser en même temps sur l’innovation, l’inventivité et la création. Il y a évidemment dans ton travail des techniques qui renvoient à l’ordre de la tradition locale, mais cette tradition est toujours transformée par une activité de recherche et de création de nouvelles manières de travailler, et de nouvelles formes.
F.K. : Absolument ! J’éprouve beaucoup de plaisir à essayer ce qui est nouveau… Mais je suis aussi très fidèle. La façon de traiter le climat est omniprésente dans mes réflexions, et je fais tout pour apporter constamment un plus sur ce qui est déjà considéré comme un acquis. Au début nous avons commencé par faire des briques… J’en suis aujourd’hui à couler des murs en terre comme on coule du béton – c’est d’ailleurs ce qui m’a valu le prix Global Holcim Awards, en 2012 – pour réduire la quantité de travail et montrer qu’on peut prendre la terre comme elle est, puis la modifier en y ajoutant du ciment. Vous voyez, je ne suis pas puriste – ou alors dans le sens où il faut s’engager, où il faut faire les choses ! Gando, c’est une sorte de centre de recherche : les idées qui fonctionnent bien sont répliquées ailleurs. Une ONG allemande a souhaité adapter le modèle de Gando, pour construire un centre de formation à Dapaong. Mais je ne pouvais pas être moi-même tout le temps sur place. J’ai donc dessiné les premières esquisses, avant d’envoyé sur place une équipe qui a formé ces gens-là, et ça marche très bien ! Je viens juste de recevoir une note du directeur de l’ONG me disant : « Francis, je peux enfin t’envoyer les photos de Dapaong ». Il ajoute qu’ils ont fait un discours où ils ont loué mon travail. Ce jour-là, le premier ministre du Togo n’a pas été invité, les autorités n’étaient pas au courant… Pourtant, il ne s’est pas passé plus de deux jours après l’inauguration pour que les responsables de l’ONG soient invités et reçus par le premier ministre et par le président. « C’est grâce à ta technique, et à ton architecture que nous avons été reçus comme ça », m’ont dit les responsables de l’ONG. Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le modèle de Gando a pu être exporté, et adapté, pendant que tout calmement je continuais à faire ma recherche…
Je ne sais pas si nous avons parlé de l’Europe ? Je suis fier de vous dire que dans quatre semaines, mon premier bâtiment sera inauguré en Europe. Savez-vous où ? À Genève, au cœur du capitalisme même ! (rires)
Voilà l’histoire : on m’avait annoncé que j’avais gagné un concours. Le responsable du projets m’explique qu’ils est contents de travailler avec moi (ah, me dis-je : tu es grand, Francis…), avant d’ajouter : « La seule qui n’a pas répondu c’est Zara Hadid… » (Ah bon ? Et j’ai gagné ? Qui donc étaient les autres ?) Cela, je l’ai découvert plus tard…
Au début du projet, je me suis dit : bon, comme je suis un grand architecte, et que c’est Gando qu’ils aiment, je vais faire une tour en pisé. Tout le monde applaudit, mais il faut trouver des exemples à Genève. Les premières recherches à travers la ville sont décevantes, jusqu’à ce qu’on trouve une villa partiellement construite en pisé. On rencontre les auteurs, les architectes et tout le monde est satisfait : « Francis va pouvoir faire du pisé ! ». On commence à développer le projet, on se rend compte que je suis capable de respecter les délais de remise des propositions : « Ainsi donc, Francis Kéré est aussi compétent que les architectes suisses ! » Vient le moment de faire les comptes : « Combien ça va coûter ? » Finalement, on se rend compte qu’une tourette en pisé à Genève coûte deux fois – sinon même trois fois – qu’en béton le plus performant. Pas question de reproduire le modèle de Gando à l’identique, il faut l’adapter. Je suis fidèle, c’est-à-dire j’essaye toujours de trouver des alternatives : nous avons travaillé avec du béton de chanvre et du bois, et je suis fier de vous dire que ce bâtiment sera inauguré dans 4 semaines. Et pendant ce temps Gando continue…
M.L. : Oui, pendant ce temps Gando continue ! Peux-tu préciser quelle est la nature du travail que tu mènes pour faire en sorte que ce laboratoire initial continue ? Et celui que tu mènes aussi pour former des jeunes architectes dans ton atelier mais pas simplement, puisque tu fais en sorte que des jeunes aillent au Burkina Faso, pour découvrir le fonctionnement de ce laboratoire permanent. Je pense que c’est important, parce que cette partie de ton activité est aujourd’hui pour toi assez fondamentale.
F.K. : On commence à travailler dans sa communauté et tout d’un coup, des gens s’intéressent à ce travail. Alors on se rend compte que tout seul, on ne peut plus rien faire – même intellectuellement – donc on a besoin des autres. C’est ce qui m’est arrivé. J’ai un cabinet à Berlin, depuis 2005, quand j’ai quitté la cuisine de mon appartement où je faisais tout, pour déménager dans des locaux que j’appelle mon cabinet – et qui est bien, d’ailleurs : si vous passez par là, venez m’y rendre visite. Ma façon de faire ne correspond pas au modèle issu de l’enseignement classique de l’architecture. Je travaille avec des Espagnols, des Anglais, des Allemands, des Français… C’est un groupe international ! Mais comment expliquer à chacun de mes collaborateurs qu’il faut faire autrement, que les dessins que nous avons appris à faire ne servent pas forcément sur place parce que vous devez vous-même être sur place pour construire ? Voilà pourquoi je fais voyager ces jeunes. Pour certains, l’expérience est brutale. Souvent comme je manque de temps, je demande à l’un d’eux de m’accompagner. Il prend l’avion avec moi, il est très heureux… On arrive au village. Je dis bonjour à tout le monde, et je présente la personne qui m’accompagne : « J’ai là un jeune qui est engagé, qui aime notre travail, il va venir passer du temps avec vous… ». Je dis aux travailleurs : « faites tout pour vous occuper de lui », et à ma famille : « faites tout pour qu’il ne meure pas de faim. » Et je repars. Ils apprennent à discuter. Car personne ne peut prétendre pouvoir tout donner tout à quelqu’un. Il faut expliquer. Nos parents nous aiment bien, ils nous entraînent à tout faire, à faire attention à la vie… Mais le plus important, c’est d’apprendre à respecter les gens. Le reste, on va le découvrir. Les écoles nous apprennent beaucoup de choses mais il y a une autre réalité. La réalité de construire n’est pas aussi facile que ça… à moins qu’on veuille suivre la voie normale, attendre soixante ou soixante-dix ans, avoir trois masters, trois doctorats avant de commencer à vivre ou à travailler ! Donc, pour plonger les jeunes dans la réalité, je les envoie au Burkina. Mais aussi, quand j’enseigne, j’organise des voyages, car il faut découvrir d’autres cultures et d’autres façons de construire…
M.L. : Tu veux aussi contribuer à développer une scène architecturale au Burkina, en t’appuyant sur l’expérience des jeunes…
F.K.. : Oui. Nous entraînons aussi les jeunes à Gando : ce sont eux qui font des projets… Mais tout ça, ce n’était pas réfléchi, ce n’était pas un plan. Je ne me suis pas levé pour dire « Voilà, j’ai appris l’architecture à Berlin, et maintenant que je suis devenu un grand maître, je vais faire… ». Non tout cela est né de la simple nécessité. Je constate qu’il y a lieu de former, et de cultiver un cadre de compétences, capable de faire les projets et aussi de profiter de mes expériences. Voilà mon combat ; c’est pourquoi je suis toujours à la recherche de gens capables d’en former d’autres, mais aussi de gérer des projets. Je pense, pour mon continent, et pour le Burkina Faso, où nous avons toujours un fort taux d’analphabétisme (plus de 70 %), que l’éducation est fondamentale. Sans elle on n’avancera jamais, donc il faut former.
M.L. : Mais ce qui te guide dans cette manière de former des jeunes architectes et des jeunes sur les chantiers, c’est que tu penses – et que tu mets pratique – : pour être un constructeur il faut aussi avoir un rapport physique avec la construction. Tu accordes beaucoup de prix au fait qu’il faille se coltiner les matériaux, éprouver la lourdeur de la terre, la rugosité du bois… Je voudrais que tu racontes un peu ce que tu vas proposer comme atelier dans cette école créée par Mario Botta : cette construction d’un mur d’argile et en quoi ça renvoie – là, nous ne sommes pas au Burkina – à cette nécessité de mettre les futurs architectes au contact de la matière et à l’épreuve de sa pesanteur et de la dureté physique de ce métier-là. C’est une chose qui pour toi est extrêmement importante.
F.K. : C’est ce qu’il faut faire ! Oui, j’enseigne aussi, car je peux bien le dire ici : œuvrer dans le domaine social n’est pas très rémunérateur, il faut le savoir. Ce ne serait pas bien, ni sage de ma part, de dire que l’argent ne compte pas. J’ai appris que l’argent compte beaucoup, et si vous faites des projets, il faut un bon client, un client qui comprenne que ce, quand nous dessinons des plans, ce n’est pas seulement du papier que nous livrons, c’est surtout de la valeur.
J’enseigne donc aussi pour améliorer ma bourse et, par exemple, dans le cas du studio à Mendrisio, je suis en Suisse. Je connais déjà l’Allemagne et ce sont des villes qui, par rapport au Burkina Faso, sont gâtées en matière d’écoles, d’universités, de formation professionnelle. Alors moi, quand j’arrive là, je vois des architectes de renom – je ne vais pas citer tout le monde, mais quand vous savez que Peter Zumthor enseigne là-bas, vous comprenez bien que ces étudiants ont tout, ils ont la crème de la crème ! Mendrisio, c’est une bonne école – je ne prends pas cela dans un sens négatif – : c’est une école élitaire.
À Mendrisio, j’avais proposé un voyage au Burkina. Malheureusement, en raison de la crise au Mali, impossible de l’envisager. Alors je dis à mes étudiants et mes assistants : « Eh bien nous allons faire un workshop ! ». Tout le monde est enthousiaste : « Allons voir le directeur financier, proposent-ils, pour demander plus de d’argent, parce que les six mille francs suisses prévus pour les frais du voyage au Mali des étudiants et assistants ne suffiront pas… » Ce à quoi je réponds : « Pourquoi aller voir le directeur financier ? Je ne suis pas là pour aller demander de l’argent. C’est vous qui allez chercher les moyens pour faire le workshop. » Tous me regardent, sans comprendre : ils croyaient que je voulais de l’argent. Je dis « Non, allez-y, amenez-moi les matériaux, et puis on va construire ensemble : on va voir s’il serait possible de faire un mur de plus de 15 mètres de long sur 2 mètres de hauteur… » Ils se lancent, ils cherchent. Ils se posent des questions, ils sont lents… Un après-midi, je reviens d’un voyage et je demande : « Où sont les matériaux ? » « Oui, nous avons écrit, mais personne n’a encore répondu, peut-être faudrait-il une lettre de l’académie, avec ta signature ? ». Moi : « Je n’ai pas le temps pour ça, je vous ai demandé d’amener des matériaux. » Tous pensent qu’il faut tout acheter. Ils ne pensent pas à chercher des alternatives… Ou plutôt presque tous, car il y a là deux jeunes filles très timides, qui ne parlent pas anglais… Elles sont considérées comme les plus faibles du groupe. Et vous savez ce que ces deux jeunes filles ont dit ? Eh bien, qu’elles avaient trouvé un chantier, sur lequel il y avait beaucoup de terre… Elles connaissaient l’adresse de ce chantier et je devais les suivre, pour voir si c’était de la vraie terre. En arrivant au chantier, nous nous sommes attardés pour parler avec un homme qui conduisait un bulldozer : il nous a expliqué son travail et la terre. Le temps qu’on revienne dans l’école, j’ai retrouvé les deux jeunes filles, en train de discuter avec un chauffeur qui venait livrer douze tonnes d’argile, de pure argile, gratuitement. Qui a dit qu’en Suisse, on ne peut rien obtenir gratuitement ?
On nous apprend qu’il faut toujours suivre une voie unique… C’est précisément cela que je conteste. C’est ça le savoir : je ne suis pas un fanatique, mais par le dialogue je parviens à dire que nous devons marcher autrement. Qu’est-ce que je peux apporter à ces gens ? L’improvisation. Et ça marche ! C’est ma façon de dire que je ne suis pas un architecte suisse : je suis Burkinabé. (Applaudissements)
Attendez de voir le résultat, j’enverrai ça à Francine (ndlr : Francine Fort, directrice d’arc en rêve) parce qu’on va construire sur un parc où il y a a des arbres. J’ai reçu ce plan pendant la pause. Ce sont des cercles, il y a des arbres suisses bien soignés, bien traités et je veux qu’on fasse une barre autour de ces arbres et faire du pisé…
M.L. : Nous verrons bien comment les arbres suisses – et les coucous suisses qui vont avec – en seront perturbés… Mais revenons à ce que tu as évoqué tout à l’heure concernant ce qu’on pourrait appeler un style, ou des choix formels, que l’on retrouve dans la plupart de tes constructions, qui sont extrêmement variées. J’aimerais que tu reviennes, en particulier, sur cette question du toit, parce que c’est un point commun à tous tes bâtiments, qui paraissent être construits à partir du toit, ce qui donne une unité stylistique à l’ensemble de ce que tu as produit.
F.K. : C’est simple : quand vous avez chaud, vous avez besoin d’un grand chapeau. Quand il pleut, si vous n’êtes pas dans une maison, vous avez besoin d’un grand parapluie. S’il neige, ou s’il y a trop d’humidité, vous avez besoin de bottes pour protéger vos pieds… Eh bien, c’est ça mon architecture. Il fait très chaud au Burkina, et ça prend beaucoup du temps pour faire pousser un arbre – cela ne veut pas dire que je ne plante pas d’arbres : ceux qui sont allés sur place savent la valeur de ce qu’on ne voit pas. Je passe beaucoup de temps à planter les arbres, à développer une technologie pour arroser ces arbres. Mais il fait tellement chaud que même la climatisation, souvent, ne marche pas. Il faut d’abord créer de l’ombre, c’est ce que je crée avec ce grand toit, et croyez-moi : vraiment, je déteste la tôle, mais je n’ai pas trouvé d’alternative pour créer des grandes salles de classe, où 100 enfants peuvent s’asseoir. Dans mes classes à Gando, nous avons minimum 60 élèves, je fais donc attention. La tôle c’est ce que j’ai trouvé de mieux pour protéger ces salles.
M.L. : On peut insister là-dessus, Francis, parce que ce que tu viens de dire – « Je n’aime pas vraiment la tôle… » – est très important : pour toi, l’attention au vécu sensible de l’architecture, c’est-à-dire le fait qu’il faille d’abord s’interroger sur ce que chacun va ressentir, en fonction des données du lieu, est plus importante que le choix du matériau. À la limite, tu peux travailler avec les matériaux que tu n’aimes pas, à partir du moment où tu estimes que ça te permettra de privilégier le vécu et le confort des habitants.
F.K. : Oui, et donner une fonction à ce matériau, voilà ! La tôle ne fait pas que protéger, elle est efficace et d’ailleurs c’est le matériau le moins cher, quand on compare durabilité et efficacité. Mais je donne encore une autre fonction à cette tôle. L’effet Venturi, c’est très simple : si vous avez une surface, légèrement inclinée, au-dessus d’une autre surface, massive, il y a forcément de l’air contenu entre les deux. La première surface s’échauffe, et l’air entre les deux surfaces s’échauffe aussi, puis l’air se dilate, il augmente de volume, donc ça se dégage à l’extérieur, et parce que la tôle est inclinée, l’air se dégage d’un côté et une aspiration produit. Toute la chaleur se dégage par le haut, donc si vous faites des fausses ouvertures dans ce faux plafond, l’air chaud de l’intérieur se dégage par là-haut, entraîné par la chaleur. Ça fonctionne et c’est très efficace. C’est un système de ventilation naturelle : c’est parce que vous bougez l’air que vous avez la sensation de fraîcheur, c’est tout. Donc même s’il fait très chaud, quand vous arrivez à faire bouger l’air, vous sentez une fraîcheur. Et c’est pour cela que les experts, quand ils arrivent dans les salles de classe, sont contents ! Et j’en suis fier.
M.L. : Tu viens d’employer le mot de durabilité : tu as, me semble-t-il, une très nette conscience qu’il faut sortir de l’idée qu’un bâtiment est là pour toujours, immuable… Il faut apprendre à considérer la ville, dans son développement, et la disparition d’un bâtiment : tu construis une architecture qui est extrêmement durable, mais avec aussi un sens très aigu de la fragilité de l’architecture.
F.K. : Oui ! Le problème que nous avons, au Burkina, c’est que nous croyons qu’après avoir construit, c’est fini. Or, un bâtiment, c’est comme un être vivant, il faut le soigner. Pour convaincre, il faut construire, et il faut que les bâtiments restent assez longtemps pour que les gens acceptent les matériaux. Nous devons développer cette culture de la maintenance. Je fais tout pour que la population soit partie prenante des projets, de telle manière qu’elle soit capable d’assurer la maintenance des bâtiments. Il faut dire aussi qu’on ne peut pas construire pour l’éternité, mais on peut développer une culture de construction, qui va perdurer dans le temps. Il faut transmettre les savoir-faire. Vous, les occidentaux, savez le faire, mais nous, nous n’avons pas ça. Le passage des savoir-faire se fait verbalement : une telle retransmission suppose une interprétation, elle contient donc des erreurs. Ce que vous avez ici, c’est ce dont nous avons le plus besoin : il s’agit de trouver un moyen d’organiser un transfert des savoir-faire, pour les autres générations.
Aujourd’hui, pour moi, ça va bien – si je peux trouver, à Bordeaux, autant de personnes qui laissent leur travail pour venir m’écouter, c’est que ça va, non ? – mais au début, mon travail n’était pas ça. Au début, je devais faire avec cette mémoire : chez nous la mémoire est très longue. Si vous faites une erreur, on va vous pardonner, mais ça ne veut pas dire qu’on l’oublie. Ma grande peur, c’était de mal faire, et peut-être aussi de me sentir bien, en Europe…
« Il n’a pas dit qu’il savait mieux faire, non. Mais voilà ce qu’il a fait. Et ça reste longtemps. » Voilà ce que l’on dit de moi, au Burkina.
Au début, les gens ont peur mais si vous arrivez à faire du bien, ça perdure aussi. Il faut avoir le courage, c’est tout. Même dans mon école, qui n’est pas au Burkina, les Allemands ont eu peur, quand j’ai dit que j’allais construire. Beaucoup m’ont demandé : « Mais pourquoi veux-tu construire tout de suite ? Attends d’avoir ton diplôme… » Et même après que j’aie construit mon premier bâtiment, on m’a encouragé à entreprendre un doctorat, avant de pouvoir continuer… Par principe, la société veut qu’on attende. Mais qu’est-ce qu’on attend ? Je suis sûr que ceux qui ont construit le bâtiment dans lequel nous sommes ici, s’ils avaient attendu, nous ne l’aurions jamais eu ! J’invite tout le monde à s’engager, il ne faut pas attendre. Je parle de la situation telle qu’elle est : nous devons éradiquer l’analphabétisme, il ne faut pas attendre. Si je prends les grands thèmes comme le réchauffement, les conflits… Qu’est-ce qu’on attend ? Qu’un groupe de politiciens, quelque part, aux États-Unis ou bien ailleurs, trouvent une solution et qu’ils nous sauvent tous ? Je n’y crois pas.
Aujourd’hui plus que jamais, je pense que la jeunesse doit s’engager. Parlez de la colonisation, faites ce que vous voulez : je m’en fous ! On peut parler du passé : ils sont venus, ont-ils bien fait, ont-ils mal fait ? Eh, qui parle aujourd’hui ? C’est notre génération, c’est à nous de nous engager, et à prouver que nous voulons un monde meilleur, au lieu de se tourner dans le passé pour dire que ce n’était pas bien. Facebook a été construit par des étudiants. Si vous voulez faire des affaires, pensez que c’est l’une des firmes la plus riche du monde aujourd’hui. Je ne peux que dire : allez-y, allez faire des forages avec des troncs d’arbres, si vous y arrivez, ça sera une nouvelle technologie. Vraiment. Il ne faut pas attendre. On est tellement tourné vers l’arrière et on nous dit d’attendre et c’est ce que je ne comprends pas…
Public : Que pensez-vous du manque d’écoles d’architecture dans les pays africains ?
F.K. : Oui, c’est une réalité, mais je crois qu’une institution est là pour accompagner, former et donner une base. Mais il faut que ceux qui peuvent œuvrer dans ce sens, essayent de pousser. Même vous. Il y a des architectes connus, qui ne sont pas passés par une école d’architecture. Ce que je critique souvent, chez mes compatriotes, c’est qu’ils attendent souvent qu’on vienne leur donner la solution. C’est bien, il faut des écoles d’architecture mais ce n’est pas tout, ce n’est pas le centre du monde. L’architecture, ce n’est pas le centre du monde !
M.L. : Nous t’écouterions pendant très longtemps… Personnellement, il me plaît de clore cette journée avec un appel à l’engagement, qui me paraît dépasser le cadre de l’architecture, et constituer une bonne idée pour pouvoir méditer pour la fin de cette soirée. Merci Francis Kéré !
F.K. : Merci.